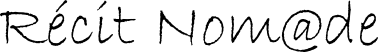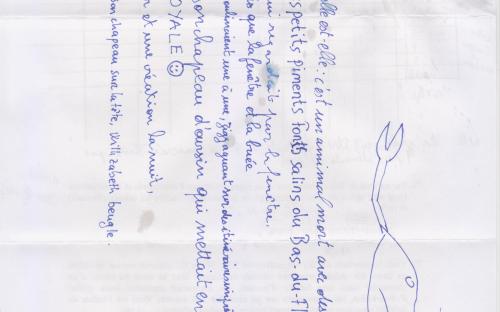Publié le 02/24/2016 - 15:47
Vendredi 2 octobre 2015 Sur les quais de l’Isle-Verte
Nous étions cinq à partir ensemble sans nous connaître. Dans le métro, une crainte m’habitait, celles des soufflés au fromage qui ne lèvent pas, des conversations mornes, des paroles raplapla.
Nous nous sommes donné rendez-vous, près d’un métro aux aurores, pour partir vers une autre île, une Île-Verte. Dans la voiture, nous nous sommes dit nos vies : «Tu travailles sur quoi?» «Le texte en fragments, un mélange entre le rêve et le vécu», «C’est intéressant et toi?», «Moi, je n’avais qu’un seul but en venant en études littéraires : celui de raconter ma vie».
À ce moment-là, quelque chose se produit. Il ne s’agissait plus de simples conversations de comptoir sur la pluie et le beau temps, le hockey, et la guerre au Proche-Orient; nous n’étions pas l’intellectualisme pur, à tenter d’expliquer, d’un point de vue sémiologique, l’importance de la lettre «m» dans «James Bond», ou encore le dédoublement du «moi» chez l’épistolier : c’était bien plus que cela.
Écrire afin de vivre, les difficultés d’apprentissage, le racisme inhérent à chacun, les joueurs de foot Italiens qui ne savent que plonger, les travers du relativisme culturel, les croyances qui donnent un sens à la vie, boire, fumer, arrêter de fumer, fumer en voyage, les drogues qui te ralentissent, celles qui te font rire, celles qui ont sept niveaux, celles qui font disparaitre le plancher, l’odeur de l’ennui, faire des «selfies» avec les chevreuils décomposés, la mort de ma grand-mère, la tristesse, le silence, la justesse politique des créateurs de South Park, «Everyone has AIDS…. AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS….» : ce sont les mots qui, autour d’une boîte de timbits, forgent une amitié.
Après quatre heures et demie de route et de mots, nous sommes arrivés dans ce petit village, près de Rivière-du-Loup, où mouillait le traversier. J’ai beaucoup pensé à toi sur les quais. Pour moi, Rivière-du-Loup est une ville comme une autre sur le bord du fleuve, une ville qui sent l’ennui. Toi, tu rêves de la visiter par ce que tu trouves son nom poétique. Je regrette le temps où je m’émerveillais pour ce genre de choses, le temps où, comme toi, je trouvais de la magie dans les choses anodines; j’aurais inventé l’histoire d’un grand loup blanc, le plus beau loup du monde, qui rôdait les jours de neige sur les berges, car il était en fait l’esprit de la rivière (un peu comme dans Princesse Mononoké, qu’il faut que tu regardes d’ailleurs). À la place, j’ai appris sur Wikipedia que la rivière tiendrait son nom des nombreux phoques qui la peuplaient et que l’on appelait jadis des loups marins. C’est pas mal moins bandant. C’est l’université qui me fait ça. À force de tout rationaliser, de tout expliquer, de tout épiloguer, je suis pris dans les dogmes de l’analyse, je ne prends plus de plaisir à l’invraisemblable, à la magie, au merveilleux.
Pourtant, sur ces berges où les hautes herbes ont les pieds dans l’eau, où les teintes du soleil décroissant peignent nos visages de si vives couleurs, où la route qui y mène fait naître les amitiés, j’ai l’impression que mon monde n’est pas totalement désenchanté.
N.
Samedi 3 octobre 2015 Le dos sur les rochers
J’ai passé la nuit dans la maison du gardien du phare. C’était bien agréable d’être si loin du bruit et des lumières de la ville, d’avoir un lit pour moi tout seul. Nos hôtes, charmants, dont j’oublie les prénoms, ont servi un petit-déjeuner nourrissant que nous avons pris en gang. Le groupe vit bien, une belle énergie y circule; pourtant, ce matin, je me la joue solo. J’en ressens le besoin. L’arrivée du petit parmi nous, il y a quelques mois à peine, ainsi que le rythme effréné de nos vies, font de la solitude ce luxe que je ne peux plus me permettre quand je suis en ville.
Dans la maison du gardien du phare, il y a, près d’une fenêtre, un beau piano en bois. S’assoir, y jouer quelques notes et perdre son regard, à travers la fenêtre, dans ce fleuve, véritable mer. Pourtant, ce sont d’autres mélodies que je cherche, celle de la houle, le son des vagues qui se brisent sur les rochers. Près du piano en bois, un tas de feuilles éparses qui ne servent à rien, j’en saisis quelques-unes pour en faire des brouillons, ceux que tu écris quand tu es en chemin.
Marcher, c’est se familiariser avec les lieux, se les approprier; c’est laisser sa trace sur cette île à jamais. Je veux m’y rendre jusqu’au bout et phagocyter, comme un globule blanc, le moindre rocher, le moindre grain de sable, les brindilles qui plient sous mes pieds. C’est la saison de la chasse sur l’Île-Verte, le bois est une zone interdite; je me contenterai de la plage.
Dans la fenêtre de la maison du gardien du phare navigue un petit bateau en hautes herbes. En m’y dirigeant, je constate que les chemins pour s’y rendre se sont effacés avec la marée. Je n’ai pas de bottes de pluie, n’ai pas trop envie de me mouiller les pieds. En temps normal, j’aurais fait demi-tour, mais j’ai pensé à toi, au rire qui aurait suivi mes protestations, à ton air décidé quand tu aurais mis les pieds dans l’eau pour avancer; j’ai pensé à toi, et je me suis frayé un chemin en hautes herbes pour arriver jusqu’au bateau que l’on appelle «L’ÉTALE». Il est beau, L’Étale, juché sur des briques pierres, il sent particulièrement mauvais aussi. À sa gauche, se déroule une immense plage de sable et de rochers que je n’aurai jamais découverte si je n’avais pas transgressé mes codes. À ce moment, je réalise plus que jamais à quel point mon esprit est balisé! C’était déjà le cas, lorsqu’en 2012, je manifestais avec la peur au ventre au moment d’aller à l’encontre de l’ordre établi; qu’il s’agisse de descendre dans les rues pour défendre nos droits les plus essentiels ou tout bonnement de traverser quand la lumière est encore rouge, je ne sais pas quitter les sentiers battus. Aujourd’hui, pourtant, c’est le cas; c’est la beauté du monde qui s’offre à moi. Le plaisir de la transgression emplit mes veines, je saute de rocher en rocher au risque de me tordre la cheville ou de disparaître à jamais, englouti par une crevasse sans fond. Je saute, si léger, sur ce paysage lunaire. En atterrissant sur un rocher, un oiseau, que je n’avais pas vu, s’envole dans un cri : mon cœur se débat avec force, je suis si vivant!
Sauter, rire, sauter, penser, sauter, grimper, crier, vivre, sauter, penser, sauter, penser à prendre le temps, s’arrêter.
La vie en ville est un mouvement perpétuel, je n’invente rien de neuf. S’arrêter pour ne rien faire me demande tant de sueur! Plus jeune, j’avais été marqué par une histoire du Petit Spirou où ce dernier, allongé sur un terrain de foot, regardait le ciel étoilé avec la sensation d’y tomber. Dès lors, j’ai toujours recherché ce vertige, mais les ciels étoilés sont si rares. Le dernier qui m’a marqué est celui de l’été 2013 à l’Anse-St-Jean, sur les rives du fjord. Aujourd’hui, c’est un ciel d’un bleu intense qui me fait face, un ciel sans traînée ni nuages. Sur les rochers, je m’allonge près des mousses vertes, je scrute le bleu dans lequel je me perds. Si je tourne la tête à droite, une lune bien présente me sert d’unique repère.
Je l’ai déjà vu mille fois, le ciel, mais jamais comme en ce moment. Il est si immense, le ciel, et je suis si infime. Il fait si peur, le ciel, et pourtant je m’y sens bien. Les pupilles dilatées par tant de lumière, je respire à son diapason. Il aurait pu me regarder de haut, le ciel, mais, à la place, il m’embrasse de tout son bleu.
Contamine-moi.
Face à cet abîme azuré, la litanie de Kuoni n’a jamais été si vraie :
Le Sphinx de Guizeh est immuable.
C’est la façon de le voir qui peut changer
Le Bouddha de Sukhothaï est immuable.
C’est la façon de le voir qui peut changer
L’idole de San Augustin est immuable.
C’est la façon de le voir qui peut changer
Ce ciel me rappelle celui de Villefranche sur mer, un jour où je m’y suis baigné lors de l’été 2004. Villefranche me fait penser à cette lettre que Cocteau avait adressée à Valéry. Je m’en inspire pour t’envoyer ce calligramme écrit sur le vif. Ce n’est certes pas de la grande littérature, il y a beaucoup de n’importe quoi, des mots tampons qui comblent les espaces, mais ça parle si bien de ce que je vis. J’y représente mon corps étendu sur les rochers ainsi que la confusion qui m’habite et toute mon urgence de vivre.
Je me redresse et vois toujours au loin la maison du gardien du phare. Il est temps pour moi de continuer ma route bondissante. Je t’embrasse.
N.
Samedi 3 octobre 2015 Ma cabane au creux des rochers
J’ai marché sans vraiment savoir où j’allais. J’aurai aimé atteindre le bout de l’île, mais je sentais bien que le temps jouait contre moi. Il fallait cependant continuer à avancer, afin de laisser derrière moi toutes ces choses qui me dérangent et dont je ne saisis pas encore très bien la portée.
J’ai peur de t’en parler : je suis fatigué en permanence. Tu me diras que c’est tout à fait normal pour un nouveau papa, mais c’est bien plus que ça. L’usure que je traîne depuis des années maintenant me rattrape; c’est celle des luttes menées pour faire ma place dans ce monde que j’ai choisi, c’est celle des boulots au salaire minimum pour financer mes études, c’est celles des nuits blanches passées aussi bien à bosser qu’à faire la fête, c’est celle du stress que cause l’impératif des notes. Jusqu’à dernièrement, je ne me posais pas trop de questions, il fallait avancer. Je me disais alors que je récupérerais le lendemain, sauf que ce n’a jamais vraiment été le cas. Aujourd’hui, demain me fait peur, car il apporte plus de fatigue. Alors je marche pour la fuir.
J’ai vu un pôle à l’horizon; persuadé qu’il s’agissait du mât d’un bateau abandonné, je m’y suis dirigé en toute hâte, heureux d’avoir trouvé un endroit où aller. La route que je me suis créé alors alterne entre gros rochers gris et plage de sable. Dans ce périple au chemin parfois vallonné, je perdis à quelques reprises le pôle de vue, mais jamais très longtemps. Il était ma quête nouvelle : je rivais constamment mes yeux sur lui, faisant abstraction des paysages. Au fur et à mesure que j’avançais, je me rendis bien compte qu’il ne s’agissait pas d’un bateau; la nature de l’objet, caché par les amas de pierres, était cependant difficile à déterminer. C’est lorsque je fus à une centaine de mètres de cet amas de bois que je me rendis compte qu’il s’agissait là d’une cabane.
J’en ai pris des photos pour toi sous tous les angles, afin d’éviter de me perdre dans des descriptions lyriques et interminables. Tu y verras comment elle a poussé au creux des rochers, comment la nature en a fait, avec les années son refuge; tu y verras qu’on y est bien à l’ombre, que l’air salin enivre et que la lumière du jour, délicieuse, y pénètre. Elle est une chapelle qui émerge de la pierre quand le pèlerin en a besoin; la halte qu’il fallait dans ma fuite. J’ai marché avec tant d’ardeur que la fatigue laissée derrière mettra bien quelques heures avant de me rattraper. Je suis si bien à l’ombre, dans cet endroit idéal pour penser, pour écrire aussi.
Tu le sais, j’aime beaucoup la stimulation intellectuelle que procure l’université, j’y ai grandi en tant qu’homme bien plus qu’ailleurs, j’y ai appris à façonner une pensée critique, à explorer le fonds des choses sans céder aux sirènes des analyses superficielles. Je me suis imbibé d’elle, elle a trempé tous les aspects de ma vie, jusqu’à ces lignes que tu lis, qui sont empreintes d’un style bien trop scolaire et dont j’ai grande peine à me défaire. À l’université, j’ai appris à tout remettre en question, sauf son propre fonctionnement. Estampé par le cynisme ambiant, j’ai rapidement compris les modèles de production qui sont exigés, qu’il fallait abdiquer bien des fois pour arriver au sommet tant convoité. Je l’aime, l’université, sauf que, je n’ai plus le temps pour grand-chose d’autre, sauf que j’ai sacrifié de belles et longues amitiés sur son autel pour la rejoindre (qu’ils apprennent à réfléchir, ces caves, qui n’ont jamais tenu un livre de leur vie et qui passent leur temps au gym ou devant La Voix), sauf que, face à ces impératifs de communications, de publications, face à ces «A» qu’il faut faire fleurir, à ces bourses prestigieuses qu’il faut décrocher, à cette compétition parfois insidieuse entre collègues, j’ai désappris le repos. Pourtant, on est intelligent, on se rend bien compte que ça n’a pas de bon sens, qu’un tel niveau de stress est malsain, que l’on meurt à petit feu. Seulement, voilà, on est lucide mais fier, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus, et pour être du nombre, il faut se transformer en une «fucking beast» comme le dit si bien une amie. Je t’avoue que je n’en peux plus, je ne vois plus le bout du chemin que je pense de plus en plus souvent à fuir.
Cette cabane, au toit perméable, offre un parfait mélange d’ombre et de lumière. Ma plume se délie et j’écris abondamment, comme à l’époque où ça me faisait du bien. Mes mots n’étaient pas parfaits, loin de là, mais ils étaient porteurs de vie et m’apportaient beaucoup de bonheur; je me trouvais bon et ma confiance ne cessait de croître. En lisant les écrivains canonisés, ces véritables maîtres de la littérature, la désillusion quant à mon niveau fut si forte que j’en perdis ma plume. Aujourd’hui, avec le recul et le savoir accumulé, j’écris mes mots différemment, je retrouve même un certain plaisir à le faire. Je me dis alors que c’est dommage d’arrêter quelque chose que l’on aime fondamentalement, parce qu’elle nous est difficile quelque temps, voire pendant plusieurs années.
Un rayon de soleil, qui filtre à travers les rondins et éclaire mes écrits, me donne raison. Ce banc, sur lequel je suis assis est confortable, bien que bancal. «L’étale» est magnifique, même s’il sent mauvais, les rochers qui m’entourent sont beaux et dangereux à la fois : certaines choses sont indissociables; l’université est stimulante et fatigante, à moi de vivre l’expérience d’une façon qui me convienne. Je sais, tu me diras que je fais de la philosophie de bas étage, c’est vrai, et après? Le monde n’a pas changé et depuis que l’homme est, ce sont les mêmes maux qui nous habitent, les mêmes paradoxes qui coexistent. Je peux être un anti-Diogène; je ne sais pas encore comment, mais ce désir brûle en moi. Je suis par contre certain qu’il va falloir lutter férocement pour y parvenir, mais je sais aussi que je ne serai pas seul à le faire. Tu te demandes surement comment je vais y parvenir avec cette fatigue qui me parasite. Je ne le sais pas non plus, mais ces quelques heures passées sous la cabane m’ont permis de goûter à un véritable repos. Il faudra donc que j’en trouve d’autres en chemin.
L’heure avance; je dois rejoindre les autres.
Bises salines et encabanées.
N.
Samedi 3 octobre 2015 Dans la maison du gardien du phare
Si, ce matin, j’étais seul, l’après-midi et la soirée se sont écrits en groupe. Des étrangers qui se racontent leur vie dans une voiture et qui deviennent amis sur le bord d’une plage, c’est aussi l’histoire de ce voyage.
En revenant de la cabane, j’ai rencontré mes amies sur la grève. J’avais manqué la visite guidée du phare, mais je ne le regrette pas plus que ça. Emballé par ma découverte, je leur montre les photos que je t’ai envoyées; on y retourne par un autre chemin. Ce symbole de repos est investi par mes nouveaux amis, cela me conforte dans l’idée que je ne serai pas seul à mener le combat; c’est une cabane agonistique, mais c’est surtout une cabane d’espoir. On s’y assoit, on y sent et goûte les herbes qui y poussent, on la quitte pour cette fois.
Après le repas, nous sommes allés sur la plage située à la droite du phare. La marée était basse. Nos pieds baignaient dans les écosystèmes, écrasant des algues brunes en forme de pattes de poulet. On ramassait alors de beaux cailloux et des coquilles d’oursins. On se parlait, on riait, c’était bien.
Les vagues déposent sur la plage leur lot de cadavres quotidien; outre ceux des oursins, les corps disloqués des crabes embellissaient le sable. Assis sur un tronc blanchi par l’eau et le soleil, nous avons décidé de reconstituer le corps d’un crabe et de le coiffer d’un oursin. Ressuscité par la magie des vents d’octobre, notre crabe raconta son histoire. Le jour, il était un soldat britannique, un de ceux qui gardent l’entrée de Buckingham Palace, la nuit, elle était une bourgeoise londonienne parée de bijoux et de mélancolie : son nom était Willyzabeth (c’est elle/lui que tu vois sur la photo). Nous poursuivîmes alors notre route, laissant notre nouvel(le) ami(e) à ses contradictions existentielles.
Nous avons également pénétré dans ce bois paisible, à l’abri des chasseurs, où nous avons aperçu dans une clairière un chalet sous lequel se trouvaient des crânes d’orignaux. Non loin de là se bécotait un couple de perdrix (à moins que ce ne soit des faisans, ou alors des pintades) que j’ai réussi tant bien que mal à prendre en photo en rampant dans l’herbe.
Nous sommes revenus par la plage, mais Willyzabeth avait pris le large, alors on a continué nos vies. Sur le sable, nous avons dressé des petits autels de pierre et de bois, adressés à je ne sais qui. Arrivés près du phare, on s’est assis sur les rochers face à la mer, on a fumé, on n’a rien dit.
Après le repas du soir, égayés par le vin, le gin, le Sprite, on a écrit ce cadavre exquis que je t’envoie en l’honneur de notre crabe chéri(e). On s’est posé sur les mêmes rochers afin d’absorber les étoiles. On a regardé le ciel en gang, sa noirceur intense, ses aurores boréales soudaines; on avait froid, on était bien.
Certains se sont laissé happer par le ciel, d’autres, dont moi, sont rentrés boire du vin à nouveau, avant d’aller se coucher. Je viens de monter dans ma chambre, c’est de mon lit que je t’écris cette dernière lettre, demain je rentre déjà.
Je ne suis pas seul. J’ai besoin de mes amis pour écrire, pour créer. Je sais que l’on reviendra souvent sur cette île, et quand la lutte battra son plein, on retournera à la cabane, une bouteille de gin à la main, des histoires plein les lèvres et des crabes dans la tête.
J’ai très envie de te voir, alors je te porterai ces lettres en main propre à mon retour en ville. Je les mettrai dans un coffret en bois pour qu’elles soient un souvenir de voyage, pour que tu les relises de temps à autre en pensant à moi. En attendant notre rencontre prochaine, je m’endors bercé par ce refrain :
« Ne regarde pas trop les bateaux, qui voguent sous la lune étrangement beaux. Ce sont tes rêves tombés à l’eau, qui continuent de courir sans capitaine ni matelots. Ne regarde pas trop les oiseaux, qui brillent sous la lune, étrangement beaux. Ce sont peut-être tes idéaux; ne regarde pas trop les oiseaux»
N.
Essai insulaire : l’invention de lettres de voyage
Vous avez lu mes lettres, celles qui relatent, en partie, le voyage fait à l’Île-Verte dans le cadre d’un groupe de recherche-création sur les récits de voyage. Voici donc une lettre, plus longue, qui explique en grande ligne, les tenants et aboutissants de la création des «Lettres insulaires».
Depuis longtemps, je désirai écrire de l’autofiction épistolaire, surtout après avoir étudié pendant une longue période des lettres d’écrivains[1]. Ce groupe de recherche était la plateforme idéale pour le faire, étant donné qu’en voyage, il est courant, voire normal, d’écrire des lettres à ceux qui nous sont chers.
Vous qui avez lu mes lettres de voyage, laissez-moi vous parler des différentes étapes de ma création épistolaire; je vous entretiendrai sur mes inspirations, sur ma méthode de création, mais aussi sur les enjeux qui sous-tendent mes écrits, les réflexions qui les habitent.
Laissez-moi d’abord vous parler des lettres de voyages qui m’ont inspiré. Il s’agit de celles que le poète Alexis Léger a incluses dans sa Pléiade, bien qu’elles étaient, comme le démontre Mireille Sacotte, pourtant fausses[2]. Je m’attarderai alors aux enjeux qui définissent une telle pratique.
Laissez-moi ensuite vous écrire tout le plaisir que j’ai eu à donner un cachet d’authenticité à ces lettres que vous savez inventées en partie. Je vous dirai alors l’importance que j’ai accordée à la matérialité et aux images, comment je me suis soucié des détails, mais aussi comment les tensions propres à l’écriture épistolaire, énoncées par Marie-Claire Grassi[3] et sur lesquelles je reviendrai, ont structuré mon discours épistolaire.
Laissez-moi vous expliquer, en terminant, comment les livres de Jean-Didier Urbain[4] et Bernard Émond[5], mais aussi le dernier album de Jean Leloup[6], ont non seulement fait naître en moi des réflexions sur l’importance de la lutte contre la banalisation et le cynisme, mais m’ont aussi permis de poursuivre celles amorcées sur la beauté et la dangerosité du monde, ainsi que celles sur l’importance de créer à plusieurs.
La lettre et le voyage
La lettre naît d’une écriture qui oscille entre vérité et invention. Dans son ouvrage, L’Épistolaire, Geneviève Haroche-Bouzinac écrit, à juste titre, qu’elle est «l’outil d’une fiction du vrai»[7]. Vous vous demandez peut-être ce qui caractérise ce mélange entre invention et réalité. Tout commence par une rencontre entre un moi du passé et un moi imaginaire, celui que l’épistolier met en scène pour son correspondant. En effet, l’auteur d’une lettre crée un personnage issu de lui-même, un «épistolier-narrateur», dont il choisit d’amplifier certains traits tout en en omettant d’autres, et ceci dans le but d’illustrer le mieux possible son propos. Il en est de même pour les événements qui sont relatés puisqu’ils sont choisis parmi la multitude de ceux qui sont vécus lors d’une journée et sont donc souvent présentés de façon enjolivée, voire inventée. En effet, dans l’étude dont je vous ai parlé, Mireille Sacotte écrit que les «lettres ne sont pas à prendre comme des documents ni sur le plan de la vérité biographique ni sur aucun autre. Elles font partie de l’œuvre et jouent un rôle dans l’œuvre»[8]. C’est d’autant plus vrai que, dans le cadre de lettres autofictionnelles, la vérité ne cesse d’être altérée afin d’illustrer au mieux les propos de celui qui écrit.
Dans l’invention épistolaire, la place de l’interlocuteur est, elle aussi, prépondérante. En effet, dans les lettres autofictionnelles, que ce soit celles d’Alexis Léger ou les miennes, les véritables destinataires sont les lecteurs de l’œuvre, vous. Pour Mireille Sacotte, l’«interlocuteur n’a d’intérêt que s’il est un symbole, un mythe, un archétype et non pas une personne réelle, et si la rencontre avec lui peut être mise en scène»[9]. Je me suis beaucoup interrogé quant à la place à accorder au destinataire de mes lettres. Si un destinataire trop incarné risquait de faire passer la relation entre les épistoliers au premier plan, et cela au détriment de l’expérience de voyage, un destinataire trop effacé dénaturerait le genre (risquant la confusion avec le journal intime). J’ai donc choisi d’invoquer un «tu» quelque peu défini. Si mon but premier était que n’importe quel lecteur puisse se sentir interpellé par ces lettres, j’ai tout de même posé, dans ces lettres, les balises d’une relation qui ne siéent pas à tout le monde, certaines remarques étant trop personnalisées.
Je vous avais également promis des explications quant aux enjeux qui structurent les lettres autofictionnelles, particulièrement celles d’Alexis Léger. Le premier élément important est le regard que le poète porte sur le paysage qui l’entoure; Mireille Sacotte nous apprend qu’il y a une véritable fusion entre les lieux visités par ce dernier et ceux de son imaginaire et que ce phénomène s’amplifie par l’écriture. Dans mes «Lettres insulaires», il existe aussi, comme nous le verrons plus tard, ce va-et-vient constant, cette frontière poreuse entre les lieux que je visite et les réflexions qui m’habitent.
Pour Alexis Léger, voyager, c’est surtout être en mouvement : «"Il n’y a rien de haïssable que l’inertie […] et l’habitude […] et le répit" disent la lettre et sa réécriture à l’unisson. Or toute la vision du monde, du poète et du poème est sous-tendue par cette idée que la vie est mouvement»[10]. Dans mes lettres, l’épistolier-narrateur est aussi toujours en mouvement, quand il explore, quand il fuit, mais aussi quand il arrête de bouger.
Écrire des «Lettres insulaires»
Je vous le réitère, l’écriture épistolaire se fait sous hautes tensions. Dans le livre de Marie-Claire Grassi dont je vous ai parlé, le chapitre «Le genre épistolaire, un genre ambigu» est consacré à ces tensions qui régissent l’écriture d’une lettre; Grassi en relève cinq : celle entre le littéraire et l’ordinaire, celle entre norme et spontanéité, celle entre présence et absence, celle entre permis et interdit, et enfin celle entre individu et société. Laissez-moi vous expliquer comment ces tensions ont toutes, à plus ou moins grande échelle, structuré mon discours épistolaire.
Pour Charles de Saint-Beuve, critique littéraire du XIXe siècle, il y a deux façons d’écrire une lettre : «Improviser ou composer»[11]. Mes «Lettres insulaires» ont été beaucoup réécrites; non seulement dans le but de les rendre plus fluides à la lecture, mais surtout pour qu’elles soient un objet littéraire et esthétique. Je les ai cependant moins relues que si j’avais écrit une nouvelle ou un poème, parce qu’il est important que la lettre porte en elle des traces de l’ordinaire. En effet, plusieurs chercheurs l’ont comparé à un «laboratoire» où l’écriture, mais aussi les idées, se forment. Il m’a été assez difficile de trouver le bon équilibre à ce niveau; j’ai, en toute logique, travaillé mes lettres plus que celles que j’envoie en temps normal, probablement un peu plus que je n’aurai dû.
L’écriture épistolaire alterne également entre norme et spontanéité. À bien des égards, je me suis tenu au cadre normatif de la lettre (la date et le lieu d’écriture au début, la signature à la fin). J’ai toutefois essayé de me montrer inventif dans le cadre de ces normes, par exemple, en désignant «le dos sur les rochers» comme un des lieux d’écriture. Il y a également ce calligramme écrit sur le vif, qui s’est imposé à moi entre deux lettres. Il représente l’épistolier-narrateur allongé sur les rochers, en train de regarder le ciel. Improvisés, certains des mots qu’on y trouve ne servent qu’à combler les espaces, d’autres sont porteurs de délires, mais tous parlent, de la façon la plus honnête qui soit, de ce que je vis.
Vous savez, écrire une lettre, c’est souvent tenir à l’autre le discours de son absence; c’est aussi une façon de se rapprocher de lui, le temps de quelques lignes. Je ne voulais cependant pas trop m’attarder à cette dynamique puisque j’ai inventé, comme je vous l’ai dit, un destinataire plutôt effacé, ceci dans le but de laisser toute la place au voyage et aux sensations qu’il procure. Les tensions entre le permis et l’interdit, mais aussi celles entre l’individu et la société sont, quant à elles, si manifestes dans mes lettres (la beauté et la dangerosité du monde, ou encore l’importance de la collectivité) que j’y reviendrai plus en profondeur lorsque je vous parlerai des réflexions qui ont nourri mon voyage.
Entre le faux et l’authentique
L’autre aspect incontournable dans mon invention épistolaire est le souci de la vraisemblance. J’ai donc pensé à plusieurs moyens qui vous permettent d’oublier, ne serait-ce que quelques instants, que vous tenez en mains des lettres inventées; je désire, au contraire, que vous les perceviez comme si elles vous étaient personnellement adressées. J’ai donc choisi pour mes lettres une police proche d’une écriture manuscrite; je les ai également glissées dans des enveloppes scellées pour que vous les décachetiez. Il importait d’ailleurs que les événements relatés dans le texte concordent avec les éléments envoyés. Par exemple, puisque dans la deuxième lettre, je parle de feuilles de brouillon volées près d’un piano en bois, je devais donc créer le calligramme sur un papier de brouillon. Il en est de même pour le cadavre exquis, puisque, pour reproduire celui que nous avons véritablement créé ce soir-là, j’ai imité plusieurs styles d’écriture, et aussi versé une tache de vin, pour montrer qu’il s’agissait d’une soirée bien arrosée. Puisque vous êtes les destinataires de mes lettres, mettre une adresse sur les enveloppes aurait faussé la donne; j’ai donc opté pour coffret remis en mains propres.
Je voulais également montrer l’importance de l’image dans ma création, moi qui me suis inspiré de l’idée suivante d’Italo Calvino :
La première chose qui me vienne à l’esprit ; quand je forme le projet d’une histoire, est donc une image dont pour une raison ou une autre le sens me paraît riche, même s’il m’est impossible de formuler ce sens en termes discursifs ou conceptuels. Dès que cette image mentale a acquis assez de netteté, j’entreprends de la développer en histoire ; ou pour mieux dire, ce sont les images elles-mêmes qui développent leurs potentialités implicites, le récit qu’elles portent en elles. […] À ce stade de l’organisation des matériaux, désormais aussi conceptuels que visuels, se situe ma propre intervention qui tend à régler l’histoire en donnant sens à son développement[12].
J’ai donc joint les photos qui ont nourri mon écriture, comme je l’aurai fait si j’avais écrit de vraies lettres en voyageant.
Lutter contre le banal
Lors de ce séjour sur l’Île-Verte, une des choses qui m’importait était la lutte contre le banal; elle passe aussi bien par le regard posé sur les choses que par l’écriture qui en découle. Il me fallait donc poser un regard neuf sur ce que bien des gens avaient vu avant moi; dans la seconde lettre, j’ai choisi le ciel, non seulement à cause de son universalité, mais aussi parce qu’il m’avait attiré ce jour-là. Lutter contre le banal, c’est regarder ce dont on a envie sans avoir peur du lieu commun; pour Jean-Didier Urbain, le désir d’éviter les clichés peut nous faire manquer bien des choses, puisqu’il écrit :
À vrai dire, à quoi bon cette idée d’un juste regard – sinon pour imposer une norme? Il y a désormais mille regards qui privent de facto le voyageur de son pouvoir discrétionnaire sur le visible et l’invisible, la profondeur du monde et le sens des choses. C’est bien ainsi! Multiplier les optiques est une excellente réforme qui écarte tous les absolus, source de discrimination. Le regard est un espace de liberté[13].
Cette idée de la multiplication des optiques qui permet l’écartement des absolus m’a beaucoup plu. J’ai donc posé mon regard à plusieurs reprises sur les mêmes objets, que ce soit de divers endroits, comme le phare que l’on perçoit de plus ou moins loin, ou à des différents moments de la journée, comme ce ciel observé aussi bien le jour que la nuit. Cette multiplication est possible également grâce à la prise de photographies; en effet, ces dernières permettent d’observer un même paysage sans limites de nombres, et cela bien que ce dernier soit figé dans le papier glacé. Cette façon de faire m’a été très utile, puisque, comme vous le savez, ce sont ces photos qui furent la première matrice de ma création.
Lutter contre le banal passe aussi par l’écriture. Si, dans ma dernière lettre, où je relate les événements d’un après-midi passé ensemble, j’ai aussi adopté un style assez dénudé, les phrases ne sont pas banales pour autant. Au contraire, le rythme que confère l’utilisation de phrases courtes, ainsi que la simplicité qui en découle, créent, à mon sens, l’impression d’un regard juste et sans filtre.
Voyager, un remède au cynisme
La lutte contre ce mal sous-tend mon texte de bord en bord. Bien que l’épistolier-narrateur trouve la vie universitaire stimulante, elle désenchante son monde. De plus, il a acquis la certitude que les façons d’être et de faire, dans ce lieu de savoir, sont figées comme dans un moule. L’urgence de partir est bien présente; le besoin d’être ailleurs se ressent fortement. Il y a trop d’images, le livre de Bernard Émond, dont je vous ai parlé, m’a grandement outillé dans ma réflexion sur la place démesurée qu’occupe le cynisme dans nos vies. Le voyage est un bon moyen de le combattre, cependant, le voyage doit s’articuler autour de trois moments charnières : l’urgence du départ (voire la fuite), le ressourcement et la prise de conscience, et, enfin, le retour et la résistance.
Le départ s’impose bien des fois à nous. Dans mes «Lettres insulaires», l’épistolier est sur le point de craquer, peut-être est-il déjà en état de fissuration avancé; il aurait été préférable qu’il parte avant, mais cela aurait donné lieu à une trame moins dramatique puisqu’il n’aurait pas écrit dans l’urgence. Partir parce qu’il le faut : quitter son environnement, s’arracher à soi-même. Je trouvais intéressant de mettre en scène un «je» qui marchait, entre autres, pour fuir son épuisement. Dans ces conditions proches de la fuite, partir comporte un risque réel, celui de ne plus vouloir revenir. En effet, la beauté du lieu, mais aussi l’absence de responsabilités et l’effacement partiel du temps contribuent à l’accroissement de ce désir.
Une cabane providentielle
La découverte d’une cabane en bois, ancrée dans les rochers, est un point tournant de mon voyage. En effet, cette dernière est aussi bien un lieu de ressourcement que de prise de décision. Dans son livre, Bernard Émond mentionne aussi une cabane, «une sorte de tente en dur sans électricité ni eau courante où je me réfugie de temps en temps dans un silence que rien ne trouble»[14].
Dans la cabane, j’étais également habité par le dernier album de Jean Leloup, À Paradis city, qui traite entre autres de voyage, mais aussi de décentrement et de recentrement, du mal de vivre ainsi que de ce besoin de lutter contre le mal qui nous habite. Cette cabane en bois, au milieu des rochers, c’est une «Zone Zéro». Entre ces murs, ce refrain jouait en boucle dans ma tête : «Zone Zéro, l’endroit que tu pleures et tu penses que tu ris; Zone Zéro, l’endroit où tu meurs et tu penses que tu vis; Zone Zéro, l’endroit où t’as peur et tu penses que tu pries». Sous ces planches de bois se passent une chose et son contraire; véritable lieu de tension, la cabane est une tombe, mais aussi une crèche.
Une fois reposé, une fois recentré, il faut retourner de là où on vient et résister. Résister, nous dit Émond, «à l’insignifiance ambiante, c’est déjà quelque chose, mais pour ne pas tomber dans le cynisme, qui est la maladie contemporaine des gens intelligents, il faut encore savoir résister à l’argent et au découragement»[15]. Il nous faut résister par l’art, par l’écriture. En effet :
L’art est à la fois une rupture et une rencontre. Une rupture, parce que l’artiste doit sortir de lui-même, combattre les évidences et la facilité, affronter et décoder le monde. Mais l’art est aussi une rencontre parce qu’il y aura, un jour, dans une salle obscure, quelqu’un à qui on parlera[16].
Résister par la communauté
Si la lutte contre le cynisme semble ardue, la bonne nouvelle est que nous n’avons pas à la mener seule; bien au contraire, il est important de pouvoir y faire face en s’appuyant sur une communauté. Il s’agit donc de tisser un réseau, car:
Il importe de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Chaque génération de cinéastes crée des réseaux d’affinités et de solidarité, à travers les institutions, des maisons de production ou des groupes informels.
On ne dira jamais assez l’importance de ces liens, et d’une certaine effervescence faite d’entraide, de discussion, de critique, d’influence mutuelle (par attraction comme par opposition) et d’émulation[17].
Vous avez sans doute remarqué que ma première et dernière lettre traitent de l’importance de la communauté, même si cette dernière rentre en tension avec l’individu, qui a besoin d’un espace propre pour s’exprimer. Ensemble, on résiste, mais surtout, ensemble, on crée. Le symbole le plus criant de cette résistance créatrice est Willyzabeth, notre crabe mort-vivant; de sa constitution, au cadavre exquis écrit lors d’une soirée bien arrosée, nous avons participé, en tant que groupe, aux différentes étapes de sa création. La force qui émane du groupe permet parfois de laisser derrière nous les faux départs, ceux que l’on aurait dû prendre, ainsi que les regrets qui les accompagnent. Personnellement, je ne sais qu’elle en est la raison, je l’ai pourtant ressenti très fortement. Aussi, ce n’est pas anodin si j’ai terminé mes «Lettres insulaires» par des paroles de la chanson «Les bateaux» de Jean Leloup.
Le monde est beau, le monde est dangereux
Comme je vous l’expliquai, ce voyage a surtout été pour moi l’occasion de me confronter à la beauté, à la dangerosité du monde. La lettre est un espace adéquat pour rendre compte de cette dichotomie, puisqu’elle est, selon Grassi, un lieu de tension entre le permis et l’interdit. Tout en gardant la prudence qui me caractérise, je voulais montrer que la transgression, l’affrontement du danger, pouvait être un moyen d’accéder à la beauté. Le monde est dangereux, certes, mais surtout le monde est beau. Pour Émond :
Nous sommes distraits, perpétuellement distraits jusqu’à l’inconscience, et la vie glisse sur nous comme la pluie sur le dos d’un canard. Sinon, comment expliquer autrement cette apathie, cette somnolence, ce coma des facultés morales? Comment expliquer que nous soyons à ce point sans réaction devant l’horreur du monde comme devant sa beauté? Tout se passe comme si nous ne croyions plus au réel, comme si nous avions abandonné d’avance l’idée que nous pouvions y vivre. Nous sommes devenus les spectateurs désabusés d’une réalité que notre inattention a vidée de sa substance[18].
La beauté ne s’offre pas à nous de façon spontanée, il faut prendre des risques et savoir lutter pour l’atteindre. Ma transgression, c’est le parcours dans les rochers qui me permet de ressentir la vie comme jamais. La beauté s’inscrit aussi dans la simplicité, que l’épistolier regarde le ciel ou qu’il passe l’après-midi en étant avec d’autres.
Comment finir une si longue lettre? J’ai encore tant de choses à vous écrire au sujet de ce voyage vécu une fin de semaine d’octobre. Si vous devez cependant retenir quelque chose, c’est que je vous écrirai encore, car le besoin de partir pour lutter contre le banal et le cynisme se fera encore ressentir; c’est que mes amis et moi, nous retournerons dans cette cabane, au milieu des rochers, une bouteille de gin à la main, afin de se réinventer sans cesse et de revenir en porteurs d’espérance.
Nathanaël Pono
[1] Nathanaël Pono, «Explorer l’atelier épistolaire. Étude de correspondances d’écrivain», mémoire de maîtrise, Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal, 2015, 115 f.
[2] Mireille Sacotte, «Une lettre et son devenir (dialogue entre une lettre d’Alexis Léger et une lettre de Saint-John de Perse)», Genesis, n°13, 1999, p.33-44.
[3] Marie-Claire Grassi, Lire l’épistolaire, Paris, Armand Colin, 196 p.
[4] Jean-Didier Urbain, L’idiot du voyage : Histoire de touristes, Paris, Plon, 1991, 271 p.
[5] Bernard Émond, Il y a trop d’images. Textes épars 1993-2010, Lux, 2011, 126 p.
[6] Jean Leloup, À Paradis City, Montréal, Roi ponpon, 2015.
[7] Geneviève Haroche-Bouzinac, Lire l’épistolaire, Paris, Hachette, 1995, p. 131.
[8] Mireille Sacotte, op. cit., p. 34.
[9] Ibid., p. 39.
[10] Ibid., p. 41.
[11] Charles Augustin de Sainte-Beuve cité dans José-Luis Diaz, «Quelle génétique pour les correspondances?», Genesis, n°13, 1999, p. 20.
[12] Italo Calvino, Leçons américaines. Aide-mémoire pour le prochain millénaire, Gallimard, Paris, 1988, p. 144-145
[13] Jean-Didier Urbain, op. cit., p.88.
[14] Bernard Émond, op. cit., p. 101.
[15] Ibid., p. 52.
[16] Ibid., p. 54.
[17] Ibid., p. 53.
[18] Ibid., p. 11.
Crédits photo: Nathanaël Pono, 2015-2016.
CALVINO, Italo, Leçons américaines. Aide-mémoire pour le prochain millénaire, Gallimard, Paris, 1988, 204 p.
DIAZ, José-Luis, «Quelle génétique pour les correspondances?», Genesis, n°13, 1999, p. 11-31
ÉMOND, Bernard, Il y a trop d’images. Textes épars 1993-2010, Lux, 2011, 126 p.
GRASSI, Marie-Claire, Lire l’épistolaire, Paris, Armand Colin, 196 p.
HAROCHE-BOUZINAC, Geneviève, Lire l’épistolaire, Paris, Hachette, 1995, p. 131.
LELOUP, Jean, À Paradis City, Montréal, Roi ponpon, 2015.
SACOTTE, Mireille, «Une lettre et son devenir (dialogue entre une lettre d’Alexis Léger et une lettre de Saint-John de Perse)», Genesis, n°13, 1999, p.33-44.
URBAIN, Jean-Didier, L’idiot du voyage : Histoire de touristes, Paris, Plon, 1991, 271 p.
.