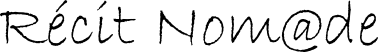Publié le 02/16/2016 - 22:45

Adirondack Northway
Sal, we gotta go and never stop going 'till we get there.
Where we going, man?
I don't know but we gotta go.
Jack Kerouac, On the Road
Novembre. La pleine lune. À l’exception de l’éclairage bleuté que diffusait la télévision, il n’y avait aucune lumière dans la maison. Du couloir, elle observait son crâne à lui. C’est tout ce qu’elle arrivait à voir ; le derrière de sa tête ; le reste de son corps étant dissimulé par le divan. Elle était immobile, incapable de bouger parce qu’elle n’avait qu’une envie et qu’elle ne voulait pas qu’il se retourne et qu’il voit l’excitation dans ses yeux. En la voyant, il aurait su qu’elle s’apprêtait à faire quelque chose d’un peu fou ; personne ne savait mieux que lui à quel point elle était impulsive. Au fond du couloir, elle pouvait discerner la porte entrebâillée menant à la chambre de son fils. La pièce était plongée dans l’obscurité, et elle n’entendait rien d’autre que ses cris monstrueux ! À cet âge (un mois) les bébés ne pleurent pas, ils poussent des hurlements qui rendent à la fois fou de rage et terrifié par l’idée qu’ils puissent ressentir une souffrance égale à celle qu’ils expriment. Un peu plus tôt, elle regardait la télévision, la tête appuyée contre les cuisses de Jérémie. C’est alors que Charles s’était mis à s’époumoner. Elle s’était levée au premier cri et s’était dirigée vers la chambre, comme un automate. Puis, à mi-chemin, elle s’était arrêtée, incapable de faire un pas de plus en direction de l’interstice noir de la porte. Les cris de l’enfant résonnaient du fond de son berceau, quelque part dans l’ombre. Elle avait seulement quelques minutes. Jérémie allait se demander pourquoi Charles s’égosillait toujours. Il allait se lever et la voir. Il lui fallait se dépêcher.
Elle se faufila dans sa chambre et, sans allumer, attrapa la valise qu’elle avait laissée près du lit depuis son accouchement. Elle qui n’était pas naturellement portée sur le ménage, elle n’avait jamais été aussi négligente que depuis la naissance de son fils. À l’intérieur de la valise, elle jeta les premiers vêtements qui lui tombèrent sous la main. Puis, elle ouvrit l’unique tiroir de sa table de nuit et prit son passeport. Heureusement pour elle, les hurlements de l’enfant couvraient le vacarme qu’elle faisait. Elle fut si rapide qu’en quittant la chambre, elle voyait toujours la nuque de Jérémie. Son émission soporifique devait l’hypnotiser, et Charles avait souvent besoin d’un bon moment avant de se calmer. Sa liberté n’était plus qu’à quelques pas. En un instant, elle enfila ses chaussures et son manteau, attrapa son sac à main et se faufila à l’extérieur, sa grosse valise sous le bras. Elle déverrouilla les portières de sa Corolla, mit sa valise dans le coffre et s’installa derrière le volant. Tu peux encore changer d’idée. Les rideaux du salon n’étaient pas fermés. Elle vit la silhouette de Jérémie se détacher sur le fond bleu : il s’était levé. Il irait voir Charles et ce n’est qu’après l’avoir calmé qu’il se mettrait à la chercher. Quand elle l’aperçut quitter le salon, elle en profita pour démarrer la voiture. Il n’est pas trop tard. Elle s’engagea dans la rue, observant défiler les maisons indissociables les unes des autres et leurs pelouses parfaites. Comment avait-elle pu laisser Jérémie la convaincre de s’installer en banlieue ? Elle sortit du quartier, gagna l’autoroute et alluma la radio. D’abord, ce fut la guitare électrique, puis la voix de Jim Morrison envahit la voiture. Elle se mit à chanter à tue-tête en appuyant sur l’accélérateur. Well, I just got into town about an hour ago. Took a look around, see which way the wind blow. Sais-tu au moins où tu t’en vas ? En se penchant pour attraper le GPS dans le coffre à gants, elle sentit son sac à main vibrer sur le siège passager : c’était Jérémie qui l’appelait. Elle augmenta le volume de la stéréo. Qu’est-ce qu’ils vont penser de toi ? Tu n’as pas le droit. Fais demi-tour. Elle mit le GPS en marche et apprit qu’elle n’avait que quarante-cinq minutes à faire avant d’arriver aux douanes. S’enfuir avait été si facile que c’en était ridicule. Heureusement que Jérémie était un bon père. Elle fouilla dans son sac à main, sortit une cigarette, ouvrit sa fenêtre et l’alluma. Te voilà qui recommences à fumer. Elle n’avait jamais été une fumeuse régulière, mais elle avait toujours apprécié accompagner les moments d’intense émotion et les soirées bien arrosées d’une cigarette. Elle se revit, à peine quelques jours après son accouchement, un verre de vin bien mérité dans une main et une cigarette dans l’autre. Elle se trouvait sur le balcon d’un couple d’amis tandis que Jérémie donnait le biberon à Charles à l’intérieur. Fannie, la femme dudit couple d’amis était allée la retrouver à l’extérieur : « T’allaites pas ?
― Non. J'y tiens pas.
― Le lait maternel c’est meilleur pour la santé de ton bébé.
― C’est ce qu’on dit.
― Alors pourquoi t’allaites pas ? »
Minuit une. La douanière l’observait en plissant les sourcils: « Why do you want to go in the United-States at this hour? » Elle hésita avant de répondre: « I am traveling and I rather do it by night. There is less traffic. » La douanière lui rendit son passeport en bâillant et la Corolla s’engagea à travers les Adirondacks.
La 87 ou l’Adirondack Northway, est une autoroute interminable bordée d’arbres. À peine une demi-heure après avoir traversé la frontière du royaume de Barack Obama, elle se mit à rêver d’un lit confortable où elle pourrait dormir loin des gémissements de Charles et du corps de Jérémie, qu’elle connaissait par cœur, et qui dégageait trop de chaleur. Elle arrivait à Plattsburgh et comme elle savait que cette ville foisonnante d’obèses comptait également un bon nombre d’hôtels, elle en profita pour quitter la 87 et pour s’arrêter dans un petit Confort Inn en bordure de l’autoroute. La chambre la moins chère coûtait 200 $ la nuit. Heureusement que ça comprend des céréales et le WiFi, autrement, dans quel type de monde vivrions-nous ? Il va falloir que tu sois plus économe si tu ne veux pas te voir obligée de retourner moisir dans ta banlieue. Elle traîna sa valise jusqu’à sa chambre, située au rez-de-chaussée, entra dans la pièce, retira ses chaussures, se faufila sous les couvertures de l’énorme lit et sombra dans un profond sommeil.
Des cris d’enfants et des aboiements de petits chiens. Deux éléments qu’elle n’appréciait pas particulièrement. Elle ouvrit les yeux en maudissant la femme de la réception qui lui avait loué, à un prix exorbitant, une chambre à côté de la salle où les clients prenaient leur déjeuner. Ce qui ne l’empêcha pas d’être d’une excellente humeur ; elle se sentait parfaitement reposée. Par réflexe, elle tendit le bras vers son sac à main, qu’elle avait déposé sur la table de nuit, et sortit son téléphone cellulaire. Jérémie l’avait appelé une dizaine de fois et lui avait laissé une panoplie de messages textuels et vocaux. Elle prit la décision de lui téléphoner en lisant le dernier message texte qu’il lui avait envoyé : « Si tu ne me contactes pas avant midi, j’appelle le 911 et je dis que tu as disparu. » Il répondit dès la première sonnerie : « Justine ?
― Salut Jérémie.
― Ça va ? T’as eu un accident ? Est-ce qui faut que j’aille te chercher ?
― Ça va. J’suis à Plattsburgh.
― Qu’est-ce que tu crisses à Plattsburgh ? »
Sa voix grave avait haussé d’un ton : il commençait à comprendre ce qu’il se passait. Elle laissa sa tête retomber sur l’oreiller moelleux du Confort Inn : « J’fais un road trip.
― Un road trip ? À Plattsburgh ?
― J’pense qu’aujourd’hui, j’vais rouler jusqu’à Portland : j’ai envie de sentir l’odeur de la mer, de manger des hot dog au homard et de boire… C’était quoi déjà, la bière qu’on a bue quand on est allé à Portland ?
― Charles a des coliques. J’ai pas de temps à perdre. Tu reviens quand ?
― J’sais pas. C’est ma fête dans une semaine. »
Jérémie fit un drôle de son : un petit rire à la fois triste et cruel : « Tu traverses une espèce de crise parce que tu vas avoir trente ans, c’est ça ?
― J’vous aime tous les deux, mais j’sais pas si c’est la vie que j’veux.
― Va chier. »
Il avait raccroché. Justine se sentit soulagée : le plus difficile était derrière elle. Quand elle sortit de sa chambre pour prendre son déjeuner continental, la salle était vide à l’exception d’un adolescent squelettique qui regardait une carte. À voir la façon dont il était habillé, Justine se dit qu’il avait peu de chances d’avoir les moyens de s’offrir une chambre à 200 $. Il devait probablement profiter du modeste déjeuner illégalement. Peu après qu’elle se soit assise pour manger son muffin et boire son café, l’adolescent plia sa carte, se leva et lui frôla l’épaule en passant près d’elle « Désolé. Oups. Sorry.
― C’est pas grave. »
C’était donc un québécois. Justine sourit ; heureuse d’entendre sa langue, même si elle se trouvait à deux pas de chez elle. Après avoir mangé et pris ses affaires, elle indiqua au GPS qu’elle souhaitait se rendre à Portland et fit démarrer la voiture. C’est vraiment ce que tu veux faire ? Te mettre à dos le seul membre du sexe opposé qui semble t’avoir un tant soit peu aimé ? Abandonner ton propre fils ? Ce n’était pas comme si Charles était entre de mauvaises mains. Il avait un père qui l’aimait et des grands-parents qui étaient déjà fous de lui.
Elle croisa l’adolescent du Confort Inn au bord de la route. Il tenait son pouce dans les airs et avait un énorme sac de randonnée sur le dos. Elle ignorait comment ses jambes rachitiques faisaient pour supporter ce fardeau. La Corolla s’arrêta près du garçon, et celui-ci, enchanté de ne pas avoir à patienter plus longtemps, s’empressa de grimper sur le siège passager. Justine répondit à son grand sourire en lui tendant la main : « J’m’appelle Justine. J’vais jusqu’à Portland et après… Après, j’sais pas.
― Portland, c’est parfait. »
Il secoua vigoureusement sa main. Justine s’engagea sur l’Adirondack Northway : « J’espère que tu fais pas une fugue !
― J’ai l’air d’avoir quinze ans, mais j’en ai dix-neuf. J’m’appelle Jonathan.»
De la poche de son manteau, il sortit un vieil exemplaire d’On the road. Le livre était en piteux état, comme si l’adolescent avait passé des années à le lire et à le relire : « Au Cégep, mon prof d’anglais m’a fait lire ça. Il parait que c’est la Bible des hippies.
― Ça parle de quoi ?
― D’amitiés, de drogue, de filles, mais surtout, de voyages en voiture à travers les États-Unis. J’fais comme Kerouac : je voyage et je m’inspire de ce que j’vis pour écrire. Sauf que moi, j’écris un blogue. »
Treize heures. Aucun nuage. Justine et Jonathan fumaient des cigarettes. Il lui en avait demandé une. Dorénavant, ils étaient sur la 89. Cela allait bientôt faire trois heures qu’ils discutaient tandis que défilaient les forêts, les champs et les villages campagnards. Ils voyaient parfois de grandes maisons blanches dont les propriétaires affichaient ostentatoirement leur patriotisme en plantant d’énormes mats surmontés du drapeau américain au centre de leurs pelouses. Justine jeta sa cigarette par la fenêtre : « J’commence à avoir faim.
― J’ai un sandwich dans mon sac.
― Un sandwich à quoi ?
― Beurre de peanuts confiture. J’l’ai fait à l’hôtel.
― J’pense que j’vais m’arrêter quelque part. »
Dix-sept heures cinq. Ils étaient arrivés à Portland. En sortant de la voiture, Justine huma l’air salin, puis elle s’étira. Jonathan lui tendit le roman de Kerouac : « Pour te remercier. J’ai pas assez d’argent pour te payer, mais j’ai pensé que tu pourrais l’aimer.
― J’peux pas accepter : c’est ton roman préféré.
― J’le connais par cœur de toute façon et je t’ai laissé une surprise à l’intérieur. »
Il embrassa Justine sur les joues, lui fit une accolade et disparut, son énorme sac de randonnée sur le dos. Elle ressentit un étrange pincement au cœur en se disant qu’elle ne le reverrait probablement plus jamais. Puis, en ouvrant la page couverture du livre, elle découvrit un joint roulé et prêt à être fumé.
Justine avait déambulé sur les vieilles routes de galets et avait apprécié le charme pittoresque de la ville. Elle avait mangé un lobster roll sur la terrasse chauffée du Portland Lobster Co, avant de retourner dans la Corolla. Les hôtels de Portland étant trop dispendieux, elle reprit le volant en direction d’Old Orchard. La plage était bordée de motels plus abordables les uns que les autres, particulièrement en novembre. En arrivant, elle préféra marcher dans le sable plutôt que de partir à la recherche d’une chambre vacante. Le soleil était couché et elle avait de la difficulté à voir où elle mettait les pieds. Elle devinait néanmoins la présence fantomatique du parc d’attractions, fermé jusqu’en mai, et celle des vagues qu’elle entendait se briser contre la grève. Enveloppée dans son manteau assez chaud pour surmonter les hivers québécois, elle s’étendit sur le dos et alluma le joint qu’elle fuma en observant les étoiles.
Elle s’éveilla au lever du soleil. Le ciel était rose au-dessus de la mer et du board walk. Elle s’était endormie sur la plage, tout près de la grille du parc d’attractions. La grande roue la surplombait. Elle sourit. Où iras-tu maintenant ?
La nuit. Un stationnement sombre. L’idée de dormir dans la voiture pour réduire au minimum les coûts du voyage. Elle avait fait le choix de s’arrêter à Boston. Justine s’était étendue sur le siège arrière et dormait depuis quelques minutes quand un homme plaqua son visage émacié contre sa fenêtre. Elle ouvrit les yeux, aperçut la grande bouche qui se tordait en grimaces obscènes, sursauta, cria. Les portières étaient verrouillées. Et s’il lui prenait l’idée de défoncer la fenêtre ? Justine s’assit et ramena ses genoux contre sa poitrine pour se rassurer. Comme si imiter un fœtus allait te protéger. Elle prit un air menaçant et cria à l’homme de partir. Il riait. Elle constata qu’il lui manquait plusieurs dents. Ce n’était qu’un itinérant. Il l’observa pendant quelques secondes, puis parti dans une autre direction. Elle se rendormit.
« The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars. » Étendue dans le lit d’une minuscule chambre d’hôtel située sur l’île de Manhattan, elle referma le livre que l’adolescent squelettique lui avait offert. Elle comprenait dorénavant pourquoi Jonathan appréciait autant Kerouac. Elle sursauta en entendant son téléphone vibrer sur la table de nuit. Il était minuit. Elle répondit : « Allo.
― Bonne fête Justine.
― Merci Jérémie. »
Les femmes, le voyage et la route
Un aspect important semble m’avoir échappé au moment où j’ai préparé mon exposé : le texte de création que vous venez de lire est inspiré d’un genre en particulier : le road novel. Pierre Monette en donne une définition dans son article intitulé Road novels : le roman-route : « Les road novels — les romans routes — sont des récits où le cours des événements se confond au tracé d'une route, dont le propos est le fait même d'être en route vers un quelque part qui importe en fin de compte assez peu1». D’où l’importance de la citation de Jack Kerouac, l’auteur qui a créé le genre, placée au début de ma nouvelle. Pour emprunter les mots de Nathalie Piégay-Gros dans Introduction à l’intertextualité : « Les épigraphes peuvent en effet apparaître comme des nœuds de sens qui rassemblent les thèmes que l’écriture va non pas développer, mais disséminer tout au long du roman : elles appellent alors une lecture rétrospective2». À la fin de ma nouvelle, la protagoniste s’en va quelque part. Où ? Le lecteur ne le sait pas et ne le saura jamais. La boucle est bouclée. On n’a pas besoin de savoir où on va, l’important c’est d’aller quelque part. On retrouve pratiquement la même chose chez Cheryl Strayed qui avance dans une direction, mais pour qui seule la route compte. Autrement, le récit ne s’achèverait pas au moment même où elle arrive à destination. Dès le prologue du récit de voyage Wild, on retrouve cette phrase qui résume bien l’ensemble du livre : « J’ai réfléchi aux différentes possibilités qui s’offraient à moi. Je savais qu’il y en avait qu’une seule d’envisageable. Comme toujours. Continuer à marcher3». L’œuvre autobiographique de Cheryl Strayed met en scène une jeune femme qui effectue une randonnée de 1700 km sur le Chemin des Crêtes du Pacifique, un chemin qui s’ét end du Mexique jusqu’au Canada. Ce travail porte sur certains aspects spécifiques aux récits de voyage de femmes de la fin du XXe siècle. Des citations tirées de l’œuvre autobiographique de Cheryl Strayed me permettront d’illustrer mes propos. Ce travail s’appuie notamment sur l’ouvrage itinéraires de l’écriture au féminin de Bénédicte Monicat pour qui « Être femme et voyager, être femme et écrire l’histoire de son voyage ne peut pas être assimilé sans distinction à une théorie du voyage que concerne uniquement l’expérience de voyageurs hommes4». C’est-à-dire que l’expérience des voyageuses est différente de celle des voyageurs et que, pour l’analyser, ça prend une théorie du voyage qui en tient compte. Or, comme l’ouvrage de Bénédicte Monicat porte uniquement sur les voyageuses du XIXe siècle et que ce qui s’applique aux œuvres de cette époque ne s’applique pas nécessairement aux récits de voyageuses de la fin du XXe siècle, mon travail s’appuie également sur le mémoire de maîtrise de Julie Houle. Celui-ci a été effectué sous la direction de Pierre Rajotte et s’intitule Récits de voyageuses québécoises (1980-2003) : en quête d’aventure et d’altérité.
Quand on fait la lecture d’un récit de voyage du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, on s’aperçoit que la description de l’espace y est très importante. Depuis, la société a vécu de nombreux changements. Le voyage s’est démocratisé et il est devenu facile, notamment avec la télévision et Internet, d’avoir accès à des images et à des informations provenant d’un peu partout sur la planète. Autrement dit, il n’est plus nécessaire de se déplacer pour accéder à des connaissances sur le monde. C’est probablement la raison pour laquelle les auteurs ont senti le besoin de renouveler la pratique du récit de voyage.
Dans son mémoire de maîtrise, Julie Houle affirme que la dimension descriptive n’est plus l’enjeu principal dans les récits contemporains de voyageuses. Selon elle, le danger serait l’un des aspects qui empiètent sur l’espace qu’occupait auparavant la dimension descriptive. Ainsi, les voyageuses de la fin du XXe siècle sont des aventurières qui partent en expédition et parlent davantage des risques que comporte leur voyage que des paysages qu’elles observent. En effet, Julie Houle écrit :
Pour ces aventurières […] le danger est tout sauf accessoire. Il n’est donc pas étonnant que l’attention de ces femmes se porte davantage sur le défi à relever, les limites à repousser… que sur les paysages à décrire. Longtemps objet central du récit, l’espace est relégué au second plan. Il devient alors le cadre, le décor de l’aventure vécue5.
Téméraires, les voyageuses veulent sortir des sentiers battus. Lorsqu’elles donnent des précisions concernant la géographie du terrain, la météo ou la faune, c’est souvent pour faire ressortir les dangers auxquels elles sont confrontées. Cet aspect des récits de voyageuses est très important dans Wild où, en guise d’exemple, la narratrice ne cesse de répéter qu’elle veut être une « guerrière amazone ». De plus, dès le début de son récit, elle insiste sur le courage dont elle doit faire preuve pour marcher sur le PCT en énumérant les nombreuses menaces qui la guettent :
La volonté de rester et de continuer envers et contre tout. Malgré les ours, les serpents à sonnette, la peur des pumas que je n’apercevrais jamais ; malgré les ampoules, les croûtes, les égratignures et les lacérations. Malgré l’épuisement, la privation, le froid, la chaleur, la monotonie, la douleur, la soif, la faim, la gloire et les fantômes qui me poursuivaient tout au long de ces mille sept cents kilomètres depuis le désert des Mojaves jusqu’à l’État de Washington (W, p. 20).
Si les voyageuses se concentrent autant sur le danger et aussi peu sur la description de l’espace, c’est souvent parce qu’il peut s’avérer dangereux d’admirer trop attentivement les paysages qui s’offrent à elles. Cheryl Strayed démontre d’ailleurs que son aventure s’avère parfois incompatible avec l’observation attentive du panorama. C’est le cas lorsqu’elle écrit :
Malgré la torture que j’endurais, je remarquais par moments la beauté du paysage, je m’émerveillais des petites choses comme des grandes : la couleur d’une fleur du désert au bord du chemin, l’immense étendue du ciel où le soleil descendait derrière les montagnes. Soudain, au beau milieu de ma rêverie, j’ai glissé sur des graviers et je suis tombée, m’affalant face contre terre avec une violence qui m’a coupé le souffle (W, p. 112).
On l’aura compris, les voyageuses doivent parfois éviter de se laisser distraire par ce qui les entoure, mais elles doivent également savoir se débrouiller dans leur nouvel environnement. Pour emprunter les mots de Julie Houle : « Le manque de concentration, au même titre que l’inexpérience ou l’incapacité d’établir clairement et parfaitement leur emplacement, est dangereux, voire téméraire6 ». Le manque d’expérience de Cheryl Strayed la conduit, par exemple, à se perdre et à se retrouver sur une montagne sur le point de se faire dynamiter.
Outre le danger, la peur occupe également une place importante dans les récits de voyageuses de la fin du XXe siècle où les narratrices sont effrayées à l’idée d’affronter le danger et parfois même de frôler la mort. C’est la raison pour laquelle Julie Houle écrit dans son mémoire : « Celles qui choisissent de vivre une aventure, une expérience hors du commun sont parfaitement conscientes des risques qu’elles encourent et cette lucidité n’a rien pour les rassurer, pour atténuer la frayeur qui s’est lovée au plus profond d’elles-mêmes7». Ainsi, la peur agit souvent comme leitmotiv dans leurs œuvres. Si les aventurières se présentent comme des héroïnes courageuses, elles n’en sont pas moins humaines et il leur arrive parfois de douter de leurs capacités. Elles vont parfois même jusqu’à remettre en question leur expédition. Cheryl Strayed se demande plusieurs fois « dans quoi [elle] s’est fourrée ». Ce qui est intéressant dans son récit c’est qu’elle met au point des stratégies pour se débarrasser de sa peur. Au début du livre, elle dit :
La peur est en grande partie due aux histoires qu’on se raconte, alors j’avais décidé de me raconter autre chose que ce qu’on répète aux femmes. J’avais décidé que je ne courais aucun danger. J’étais forte. Courageuse. Rien ne pourrait me vaincre. M’en tenir à cette histoire était une forme d’autopersuasion, mais, la plupart du temps, ça fonctionnait (W, p. 85).
Autrement dit, ce n’est pas parce que les voyageuses de la fin du XXe siècle ressentent l’appel de l’aventure qu’elles sont à l’abri du doute.
La peur et le doute pourraient facilement convaincre les auteures de récits de voyage contemporains de rebrousser chemin. Mais comme le fait savoir Julie Houle : « Malgré la peur qui les dévore et la tentation parfois grande de baisser les bras, toutes les voyageuses sans exception vont jusqu’au bout, atteignent l’objectif fixé8». Si les aventurières sont effrayées et souffrent des conditions qu’elles s’imposent à elles-mêmes, leur désir de se surpasser s’avère plus grand que la frayeur et même que la douleur. D’un côté, elles sont terrifiées par les dangers qu’elles rencontrent, mais de l’autre, elles ressentent une certaine satisfaction à l’idée de vivre une aventure qui sort de la norme. D’ailleurs, la joie qu’elles ressentent à la fin de leur périple surpasse probablement toutes les émotions négatives qu’elles ont pu ressentir pendant celui-ci. Cheryl Strayed raconte le moment où elle atteint l’objectif qu’elle s’était fixé dans ces mots : « J’étais arrivée. Je l’avais fait. C’était si insignifiant et si magistral à la fois – une sorte de secret que je me répéterais longtemps, même si je n’en saisissais pas encore la portée (W, p. 487) ».
Dans Itinéraires de l’écriture au féminin, Bénédicte Monicat écrit :
L’écriture du voyage ne va pas de soi pour la femme et la voyageuse doit justifier son parcours par rapport aux conventions de ce que doit être, faire et écrire la Femme. En se rapprochant de ce qui est valorisé par l’expérience masculine, la voyageuse tente de parvenir à la reconnaissance de sa propre valeur, mais pour ce faire elle doit s’interdire d’être femme9.
C’est probablement pour cette raison que Cheryl Strayed mentionne : « j’étais "la seule fille dans les bois", ou en tout cas au milieu de ce groupe d’hommes. Sur le chemin, je sentais que je n’avais pas le choix : afin de neutraliser la sexualité des hommes que je croisais, je devais leur ressembler le plus possible (W, p. 179-180) ». L’auteure de Wild renie sa féminité malgré elle pour se sentir acceptée et éviter le danger que peuvent représenter certains hommes autour d’elle. En effet, elle écrit : « J’avais toujours été une vraie fille, habituée à tirer parti de mes atouts. À l’idée que je ne puisse plus me reposer sur eux, mon ventre se nouait (W, p. 180) ».
Julie Houle souligne l’importance de la rencontre avec l’autre dans les récits de voyage de femmes publiés entre 1980 et 2003 : « Le but de leur périple n’est pas précisément d’étudier les mœurs des populations locales, comme le feraient des ethnologues, mais la très grande majorité d’entre elles s’intéresse à l’Autre et lui consacre de nombreuses pages de leur récit de voyage10». Lors de notre fin de semaine à l’Île-Verte, j’ai été surprise de me voir rechercher la compagnie d’individus qui m’étaient inconnus à peine quelques heures auparavant. N’est-ce pas l’une des spécificités du voyage de permettre aux amitiés de se tisser facilement ? Dans Wild qui comme ma nouvelle se déroule aux États-Unis, les autres ne sont pas très exotiques, mais ils font tout de même partie d’un groupe qui partage une culture que Cheryl Strayed ne connaît pas très bien : ce sont des randonneurs. Ils sont très accueillants avec elle, ils lui donnent des conseils et même si elle s’est promis de faire sa randonnée en solo, elle est toujours heureuse de les voir et de passer un moment avec eux. Lorsqu’elle rencontre un petit groupe de randonneurs pour la première fois, elle écrit : « Nous avons discuté du chemin brûlant désormais derrière nous et du chemin gelé qui nous attendait. Aussitôt, j’ai éprouvé la même chose que lors de ma rencontre avec Greg : j’étais tout excitée de les voir, même si leur présence soulignait un peu plus à quel point j’étais mal préparée (W, p. 153-154) ». Julie Houle mentionne que les voyageuses de son corpus présentent les natifs des pays qu’elles visitent comme étant des gens honnêtes, intègres, accueillants et altruistes. La plupart des gens que rencontre Cheryl Strayed lui ouvrent les bras de la même manière : « Mis à part deux expériences désagréables […], on ne m’avait témoigné que de la générosité. Le monde et ses habitants m’avaient ouvert les bras à chaque tournant (W, p. 469) ».
Dans son article intitulé Les écrivaines de récits de voyage du Québec : esprit féminin et lieux du savoir chez Jacqueline Darveau et Marie-Ève Martel, Mariève Maréchal explique que les récits de voyages contemporains de femmes possèdent souvent une forme qui s’apparente à celle de la fiction. C’est-à-dire qu’ils ont des caractéristiques du roman ou du recueil de nouvelles. Wild est divisé en parties et en chapitres à la manière d’un roman et ceux-ci portent des titres comme « La séparation », « Chemin », « La seule fille dans les bois » ou « La reine du PCT ». Le voyage est donc mis en scène à la manière d’une histoire qui nous serait racontée. Au début de chaque partie, Cheryl Strayed a également ajouté une ou plusieurs épigraphes telle que : « La chute d’un si grand homme aurait dû faire plus de bruit (W, p. 17) ».
Enfin, au sujet des descriptions que font les voyageuses de la fin du XXe siècle, Mariève Maréchal écrit : « la description ne vise pas ici à partager une réalité statistique ou bien à mettre de l’avant le discours de certains spécialistes. Bien au contraire, il s’agit de raconter son voyage à sa manière, à travers sa propre perception11». Or, depuis les dernières années, les femmes qui écrivent des récits de voyage ont tendance à décrire davantage de situations qui relèvent du privé. Lorsqu’elles se déplacent dans l’espace, elles se concentrent davantage sur ce qu’il se passe à l’intérieur d’elles que sur ce qu’il se passe à l’extérieur. Pour emprunter les mots de Mariève Maréchal : « L’auteure attire ainsi l’attention sur l’expérience humaine individuelle, celle des autres ou bien la sienne plutôt que sur son voyage, sur les villes ou sur les paysages12». Cheryl Strayed alterne, à travers sa narration, entre différents souvenirs et sa randonnée sur le PCT, comme si sa randonnée et ses souvenirs ne pouvaient pas être évoqués l’un sans l’autre : « Au cours des années qui avaient précédé la disparition de mes bottines dans le ravin, j’avais dansé au bord du précipice. J’avais erré, tourné, dérivé – du Minnesota à l’Oregon en passant par New York, puis à travers tout l’ouest du pays – jusqu’à me retrouver là (W, p. 12) ».
BIBLIOGRAPHIE
- 1. Monette, P. (2006). Road novels : Le roman-route. Entre les lignes : Le plaisir de lire au Québec, 2(4), p.30.
- 2. Nathalie. Piégay-Gros. (1996). Introduction à l’intertextualité. Paris : Dunod, p. 102-103
- 3. Strayed, C. et Guitton, A. (2014). Wild. Paris : 10-18. p. 16. Désormais, les références à cette oeuvre seront indiquées par l'abréviation W, suivie du numéro de page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
- 4. Monicat, B. (1996). Itinéraires de l’écriture au féminin voyageuses du 19e siècle. [s.l.] : Amsterdam Rodopi, p. 6.
- 5. Houle, J. (2006). Recits de voyageuses quebecoises (1980--2003): En quete d’aventures et d’alterite. ProQuest Dissertations Publishing.
- 6. Houle, J. (2006). Recits de voyageuses quebecoises (1980--2003): En quete d’aventures et d’alterite. ProQuest Dissertations Publishing.
- 7. Houle, J. (2006). Recits de voyageuses quebecoises (1980--2003): En quete d’aventures et d’alterite. ProQuest Dissertations Publishing.
- 8. Houle, J. (2006). Recits de voyageuses quebecoises (1980--2003): En quete d’aventures et d’alterite. ProQuest Dissertations Publishing.
- 9. Monicat, B. (1996). Itinéraires de l’écriture au féminin voyageuses du 19e siècle. [s.l.] : Amsterdam Rodopi.
- 10. Houle, J. (2006). Recits de voyageuses quebecoises (1980--2003): En quete d’aventures et d’alterite. ProQuest Dissertations Publishing.
- 11. Maréchal, M. (2015). Les écrivaines de récits de voyage du Québec. Esprit féminin et lieux du savoir chez Jacqueline Darveau (1938) et Marie-Ève Martel (2011). @nalyses, 10(1). Récupéré de https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article...
- 12. Maréchal, M. (2015). Les écrivaines de récits de voyage du Québec. Esprit féminin et lieux du savoir chez Jacqueline Darveau (1938) et Marie-Ève Martel (2011). @nalyses, 10(1). Récupéré de https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article...