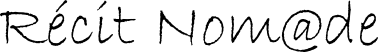Publié le 10/15/2015 - 14:03
« Le voyage est un état d’esprit », Nicolas Bouvier
Cent-quatre-vingt-neuf kilomètres, deux heures dix-huit minutes de voiture, et une heure de traversier me séparent de l’Île Verte et de l’écriture. Je suis contrariée. Je me sens égoïste de l’être.
Ce voyage ne me procure pas le même réconfort que celui qui était prévu. Il en a pourtant tous les contours. La même frébrilité d’avant les départs lorsque je boucle la valise, que je prépare les collations, les bouteilles d’eau. Je démarre la voiture, j’allume la radio. J’échappe à la circulation de Montréal et me dirige vers l’est.
La route familière a ses couleurs d’automne, toujours aussi spectaculaires. Des cars de touristes asiatiques sont garés le long de l’autoroute et prennent des photos des érables rouges et des saules jaunes si typiques des toiles de René Richard. Le soleil de cette douce journée du début d’octobre laisse présager un voyage sans heurts. Les randonnées en solitaire sont les plus propices à ma réflexion et à mon équilibre. J’aime conduire. Je me sens libre au volant d’une voiture, je suis protégée des agressions.
Il y a les haltes obligatoires que je m’impose comme pour narguer le passé alors que les arrêts, lors des voyages en famille, étaient interdits. La route était longue jusqu’à la destination finale et malgré nos supplications, tassés en sardine sur la banquette arrière, nous devions nous retenir. La chicane finissait toujours par éclater entre les sept passagers, tant l’inconfort était grand. Ce souvenir produit encore sur moi une irritation épidermique.
Drummondville : un café pour me tenir éveillée. Ne pas oublier le petit sac de fromage en grain. Le seul que je mange en déplacement. Si le temps le permet, un détour vers les serres Roses Drummond pour des fleurs fraîches et une brioche à la cassonnade qui répand l’odeur de ma grand-mère dans la voiture. Beauport, le dernier plein avant le Parc des Laurentides. Interdit de « gazer » à l’Étape où le prix de l’essence est ridiculement hors de prix dans cet espace hors du temps. Je m’y arrête, même si je suis presqu’arrivée à la maison. Il y a toujours des visages connus, malgré le temps qui passe. Je n’utilise pas leurs toilettes, l’odeur d’eau de javel et les ventilateurs bruyants m’énervent. Je sais me retenir.
On ne se lasse pas du Parc des Laurentides. La lumière n’y est jamais la même. Deux-cents kilomètres de route valonneuse à travers la forêt. Je reconnais les panneaux des ZEC, des sites de l’Université Laval, et ceux des centres de plein-air que je fréquentais adolescente. Les souvenirs remontent à la surface. Je traverse ce parc depuis toute ma vie et à chaque coup, mon regard s’imprègne d’une nature différente. J’arrive presqu’à destination. Les premières maisons et les cheminées de l’usine qui laissent échapper leur écume blanche se profilent au détour de la dernière montée. Je dépasse la sortie qui mène à notre chalet. J’ai vécu plus longtemps à Montréal que dans ma région, mais c’est ici que je me sens enracinée, malgré un accent que j’ai de plus en plus de difficulté à saisir. Les dépanneurs, la maison du coin à Laterrière, l’embranchement vers La Baie, le méga centre commercial, le petit centre-ville déserté d’Arvida que des courageux essaient de revitaliser, sont inscrits dans mon ADN.
Là s’arrête les comparaisons avec ce qu’aurait pu être le voyage vers l’Île Verte.
La toux creuse du voisin derrière le rideau, le va-et-vient du personnel de garde, les tubes et les écrans cathodiques verts me donnent froid dans le dos. Au moins ce n’est pas le couloir de l’urgence. J’observe le visage pâle de l’homme endormi. Sa main, piquée d’une canule, repose inerte sur le lit. Les veines gonflées, sont bleues et saillantes Je n’ose toucher la main que je reconnais à peine. Cet homme amaigri et vieilli, si fort autrefois, c’est mon père. Il va peut-être mourir. À cette idée mon cœur se comprime de douleur au diapason du sien, terrassé par la crise. Une infirmière prend les mesures sur le moniteur et consigne des notes au dossier. Pas un mot, pas un geste à mon endroit. Il est quinze heures trente, elle est pressée de partir. Une conversation la retarderait. Le travail déshumanise.
Je somnole, mes pensées vagabondent. L’Île Verte. Je pense aux pages qui s’écrivent, aux relations qui se tissent. Je me sens mélancolique. C’est avec lui que j’y suis allée la première fois. J’avais peur sur le traversier. Il m’a prise dans ses bras puissants, le crachin frappait mon visage d’enfant. Sur un polaroïd pris par ma sœur, je suis accrochée à son cou, l’air terrorisé. Mon père rit.
C’est avec lui que j’ai traversé les Maritimes, la côte est des États-Unis, l’ouest Canadien. Il m’a fait aimer les voyages et ressentir l’immense bonheur de rouler, juste pour rouler. À sa manière, il a fait en sorte que j’apprivoise le silence, mon plus précieux compagnon. C’est en pensant à mon père que pendant un séjour à San Francisco, et sur un coup de tête, j’ai loué une décapotable, longé la côte ouest et me suis rendue à San Diego y rejoindre des amies pour le souper. Neuf heures de pur bonheur, le nez au vent et un souvenir qui ramène la joie, les jours de tristesse.
Je suis heureuse d’avoir fait ce voyage. Je tiens sa main dans la mienne.