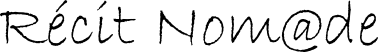Publié le 01/31/2016 - 02:50
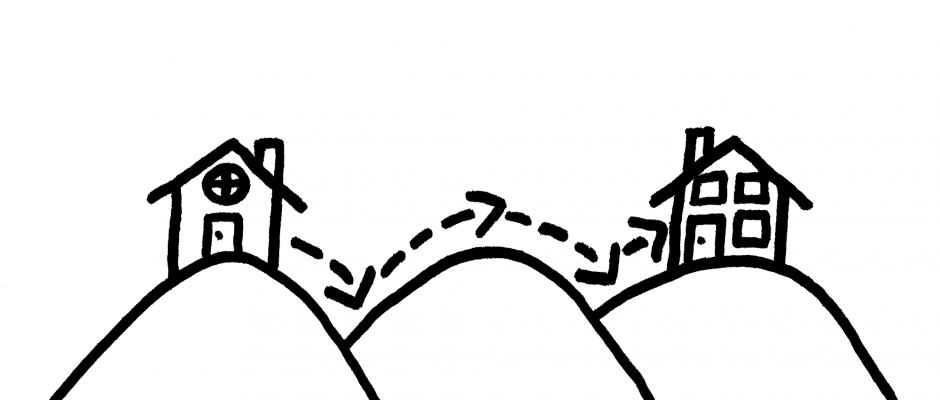
« Chaque ethnie se rattache à un élément du milieu écologique pour y fondre un système qui lui permet de survivre à travers une vision du monde spécifique. »
« Le discours géographique actuel, volontairement desséché, n'exprime qu'une part de la réalité : il existe entre l'homme et son sol, entre l'homme et son paysage, d'autres niveaux de relation. » (Joël Bonnemaison, « Voyage autour du territoire », p. 252)
Le mot « culture », dans bien des langues, tient ce double sens particulier : il définit à la fois les particularités d'un peuple, mais aussi, le sol que ce dernier cultive.
Pourquoi ces deux notions se retrouvent-elles ainsi reliées dans le même mot ? C'est peut-être parce que l'une est, en partie, le résultat de l'autre : notre lieu de naissance, la terre qui nous voit naître, a une immense influence sur notre manière de penser, de percevoir les choses. Des sols différents font des gens différents.
Histoire vraie : Quand j'ai déménagé à Montréal, à ma première soirée après mon arrivée, une fille s'est introduite à moi en me disant :
« Tu viens de Sherbrooke toi hein ? J'dis ça, parce que t'as vraiment des gros mollets. »
L'association entre une ville et la taille des mollets paraîtrait probablement saugrenue et étirée à toute personne venant d'ailleurs. Pour comprendre, il faut ainsi savoir que la ville de Sherbrooke est réputée pour ses dénivellations constantes. Construite en plein milieu d'un paquet de montagnes (probablement pour rendre les choses faciles...), n'importe quelle marche dans cette ville d'un point A à un point B nécessite de descendre et (surtout) de monter diverses côtes. On s'y promène donc toujours en zigzagant, non pas de gauche à droite, mais bien de haut en bas.
Et bon, que la taille de mes mollets soit plus grande que la moyenne ou non, n'en reste pas moins que, juste dans ma manière d'être ou de parler, cette situation a effectivement causé certaines différences.
À chaque fois que j’entends un Montréalais se plaindre d'une côte à monter, comme un réflexe, je me mets toujours à lui dire un truc du genre :
« Ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu forçant monter Saint-Denis jusqu'au métro Sherbrooke. Mais t'essaieras pour voir de venir dans ma ville pis de monter la Terrill pour te rendre jusqu'au Cégep une fois. Après ça, tu reviendras m'en parler...»
Et je constate à peu près le même discours chez tous mes amis qui viennent du même coin que moi. Pour eux aussi, quand ce genre de situation se présente, il leur faut rectifier les faits auprès de celui qui se plaint en lui disant que :
« Toi t'as jamais monté la côte King pis ça paraît, ou la Prospect, ou, encore moins, la Don Bosco. »
Ces endroits ont des noms que toute personne venant de là est capable de visualiser. Si je dis que je suis sur la Terrill, n'importe qui connaissant un peu Sherbrooke sait tout de suite très exactement sur quel bout de la rue Terrill je me trouve : celui qui fait mal aux mollets.
C'est dans le langage.
Et malgré tous les efforts qu'on peut faire pour s'en débarrasser, c'est ancré dans nos têtes.
Je n'ai, honnêtement, pas tenté de garder grand chose de ma ville natale. Je dois l'avouer : comme n'importe quel adolescent de région, dès que j'ai pu quitter l'endroit qui m'a vu grandir et qui me semblait trop petit, je suis parti, autant physiquement que mentalement.
Pendant longtemps, j'ai voulu m'éloigner le plus possible de tout attachement à une région. Et, en grande partie, ça a marché : étant descendu seulement huit fois en quatre ans dans ma ville (et pour de courts séjours seulement), il n'y a plus grand-chose qui me reste encore là-bas que je pourrais pointer du doigt pour en dire « Ça, ça me rend différent des autres. »
Mais tout ce qui touche au sol, on dirait que c'est plus dur de s'en déraciner. Chez moi, autant que chez tous les autres qui viennent de là, je remarque donc toujours cette manière spéciale de considérer le terrain. Même après des années, on a toujours ce besoin constant de rectifier, à tout Montréalais se plaignant de devoir escalader des collines, que lui n'a jamais dû affronter des vraies dénivellations de terrain comme on en retrouve par chez nous.
Comme si, se sentant attaqués, il nous fallait soudainement et à tout prix défendre nos côtes.