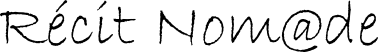Publié le 10/29/2015 - 16:42
RÉCIT NOMADE : Tout d'abord, peux-tu nous expliquer comment s'est structuré ton voyage en Colombie-Britannique, compris entre mai 2012 et février 2014? S'est-il fait en une ou plusieurs séquences? Peux-tu nous raconter ce périple, ou plus précisément ce qui l'a suscité – l'intuition qui le précédait.
MARC-ANDRÉ : D'abord, le voyage s'est fait en deux temps. Le premier a duré cinq mois (de mai à septembre 2012). Puis comme j'ai ressenti très clairement le besoin de poursuivre ce que j'avais commencé, car il y avait là-bas des choses qui restaient inachevées et continuaient de m'appeler, eh bien j'y suis retourné un an plus tard, en septembre. Et cette fois j'y ai passé l'hiver. J'ai ensuite su que mon cheminement là-bas était fait, et que des « fantômes » me réclamaient alors à nouveau à Montréal.
L'intuition derrière ce voyage, c'était le manque de confiance en moi, et le manque d'indépendance. C'est ce qui m'a poussé à quitter le nid familial. J'étais un p'tit gars de la banlieue (et je le suis sans doute encore un peu), qui vivait chez m'man pis p'pa. Mes parents se sont rencontrés à la Caisse populaire Desjardins, ils y travaillent les deux. Donc chez nous ça parle en reer. J'étais en réaction par rapport à ça, je ne voulais rien savoir de cette structure-là. C'est donc le manque de liberté, le manque de conscience de soi qui étaient à l'origine de mon départ. Aussi, la croyance qu'il y a autre chose. Une alternative à « la boîte ». Une sorte de révolte, finalement, une crise d'adolescence tardive.
RÉCIT NOMADE : L'idée du récit photographique, était-elle inhérente à ce voyage, ou bien si elle est apparue en cours de route, comme accident?
MARC-ANDRÉ : D'abord, je ne me considère pas vraiment comme un photographe. Ce que je fais ressemble plus à un journal photographique. Parce qu'en fait je n'ai jamais eu « les mots ». Moi, c'est les images, et je les travaille dans la volonté d'isoler des symboles. Ce voyage-là représente une quarantaine de rouleaux de négatifs (35mm) qui avaient un rapport ensemble. Je voulais travailler en série, en livre : parce qu'il y a un flot. En fait mon récit Il y a une entrée sera en trois parties, et ce livre-ci vaut pour la première, la seule qui soit aboutie à ce jour. Chaque partie se voudra un flot en elle-même, mais elles traitent toutes du même voyage, de la même transformation.
Je pense que l'idée était là au commencement. J'ai toujours aimé les récits photographiques, les livres de photos, le do-it-yourself. Mais le tout s'est bien sûr structuré en chemin, en faisant une sélection toujours plus précise de mes photos.
RÉCIT NOMADE : Et le livre-objet? Pourquoi as-tu pensé à cette matérialité particulière? Quelle était ta relation avec les livres artisanaux à ce moment?
MARC-ANDRÉ : Je trouve ça beau, et important, de donner une vie physique aux images. Également, c'est le fait de les placer en série. Je suis quelqu'un de bien manuel, et j'aime les petits objets. Par exemple l'enveloppe du livre est faite à la main, pour inciter une relation à l'objet. Je voulais aller plus en profondeurs, dans la mise en page, les proportions... Il y a le photographe Alec Soth qui m'a vraiment allumé, avec ses photos en noir et blanc, son rapport au voyage, son approche documentaire. C'est une sorte de mentor à mes yeux.
RÉCIT NOMADE : Une question vaste : comment penses-tu que ta « posture d'artiste » intervenait dans ce voyage? As-tu l'impression qu'elle t'offrait plus de prises sur le monde? Ou plus de fascination... Te rendant plus apte à l'abstraction, à la volonté de ne pas tout définir, à rester plus « à l'écart » de certaines choses du monde, si on peut le dire ainsi?
MARC-ANDRÉ : Ça produit effectivement plus de fascination... Dès le départ j'identifiais un désir de création, dans tous les sens du termes (création personnelle, artistique, etc.). Puis il y a des défis qui interviennent avec la caméra. C'est que ça devient difficile avec la photographie de te laisser aller, sur le vif, d'être le témoin et le participant à la fois. Ma posture exige de me faire discret, puisque l'effet que je veux garder est un « naturel ». Mais, en même temps, je désire tellement être présent... avec vous, sur le bord de l'eau, la nuit, à jaser par exemple, à être là. Ça devenait donc tout à fait génial – parce que je faisais des travaux de toutes sortes au fil de ce voyage – lorsque j'arrivais par exemple à taper du marteau et à prendre des photos en même temps, ou à jouer dans la terre…
RÉCIT NOMADE : Que cherchais-tu donc à documenter à travers tout ça?
MARC-ANDRÉ : Ce que je cherche à documenter, c'est ma relation au sujet. Parce qu'il y a déjà une relation, avant la photo, mais je me demande : comment c'est possible de composer sur le vif? C'est ça qui m'intéresse.
RÉCIT NOMADE : Dans ton texte introductif au livre, tu parles de « redécouverte et redéfinition du monde ». Ainsi, l'on comprend que le voyage est venu renouveler ta sensibilité face au monde, ta relation à lui, une relation qui devient sans doute plus philosophique et plus éprouvée, plus consciente. Yon Rivard évoque « cette force dont tout surgit et se renouvelle dans le passage incessant de la nuit au jour et du jour à la nuit »1. Peux-tu nous parler plus de cette « redécouverte », qui à mes yeux est un mot bien chargé, et inspirant.
MARC-ANDRÉ : Eh bien tu sais, on vit des signes, que ce soit avant une transformation, ou avant un shift de travail... À mes yeux, il est évident qu'à une époque, je ne m'appartenais pas, ou que je n'assumais pas qui j'étais. Par rapport à mes parents, à ce milieu exigeant, je me sentais vraiment différent, mais j'avais de la misère à voir les alternatives comme étant réalistes. Quand il s'agissait de penser à l'avenir, il fallait toucher à quelque chose de concret, de très précis. Mais moi, je ne pouvais pas penser au-delà de ce que je ressentais. Ainsi, devant le concept d'avenir, je rencontrais un certain mur. Mon père avait de la difficulté à me comprendre et ne savait pas comment m'encourager, il y avait une sorte de malaise, lui dans une culture de sport et de performance, moi qui ai vite préféré la musique, les arts. Je sentais que je ne le satisfaisait pas.
Ce voyage-là m'a permis de voir qu'on pouvait gagner son pain de bien d'autres manières. Comment faire pour être heureux, et cultiver le bonheur en faisant des choses simples? L'île de Salt Spring Island (au nord de Victoria dans les îles du golfe) est de tradition bien roots, réputée pour ses artisan-e-s et travailleurs-euses indépendant-e-s, entreprises locales, fermes biologiques et initiatives écologiques de toutes sortes. J'ai aussi rencontré là-bas des gens qui voyageaient parfois depuis des années, et vivaient sur le bord des routes et des rivières. Paradoxalement, tout ça m'a énormément responsabilisé. De me retrouver seul, aux rênes de mon vaisseau. Faire du jardinage, et cumuler des petites réalisations, sans le besoin d'un titre quelconque. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que la société pointe uniquement les grandes réalisations.
RÉCIT NOMADE : Je proposerais de faire un détour vers le sacré. Car c'est quelque chose qui nous a interpellé pas mal dans cette recherche, prenant conscience que le voyage rime souvent avec expérience initiatique, et renforce notre lien avec le monde, lien soudainement plus large, vertigineux et engageant qu'on ne le soupçonnait, plus existentiel aussi. Par exemple, pour Durkheim, « la religion est essentiellement une expérience d'ordre affectif. Plus précisément, c'est celle de l'effervescence collective du sacré (aux antipodes, donc, de la routine quotidienne). »2 Peux-tu nous parler de ton rapport au sacré? Ou peut-être y a-t-il un mot qui conviendrait plus à tes lunettes.
MARC-ANDRÉ : D'entrée de jeu, je peux affirmer que le voyage c'est un rite de passage pour moi. Le but était nul autre que sacré. La deuxième fois que je suis parti, j'ai vécu dans un petit camper, en me disant : observes-toi bien maintenant. Je suis content que tu parles de sacré, car je suis quelqu'un de bien spirituel – je ne sais pas comment le dire autrement; dans notre conception, c'est comme si spirituel et religieux marchaient côte à côte, ce qui me paraît problématique.
Au-delà de documenter ce que j'ai fait, avec qui j'étais; je pointe des symboles avec mes photos, des figures. J'aime aussi traiter la mort dans mes photos. On a souvent une vision décolorée de la mort, ce qui explique mon traitement en noir et blanc. Parfois, je fais ressortir des démons dans mes photos, il y a carrément une autre présence qui est là, il n'y a pas que le « sujet »... Je sentais que j'avais des démons, je voulais les extérioriser, les voir – un démon étant quelque chose qui t'empêche de fonctionner, que tu essaies trop de comprendre. Tes petits démons sont bien mieux sur ton épaule, que reniés. Donc l'aspect obscur de la photographie, j'ai aussi voulu l'explorer. J'ai également une photo qui est prise au-dessus des nuages, c'est très suggestif, d'ailleurs la brume est omniprésente là-bas à l'automne. Alors oui, le sacré, j'y étais.
RÉCIT NOMADE : Pour revenir à ton introduction dans le livre, parce qu'en fait c'est le seul endroit où tu livres des clés de lecture, tu évoques les pièges de la matière, du corps et de l'esprit. C'est intriguant... pourquoi « les pièges »? Et, comment intervient la photographie dans tout ça, est-ce qu'elle se fait prendre ou bien si elle permet de cibler lesdits pièges, de les éviter?
MARC-ANDRÉ : Je ne sais pas si c'est le mot juste, c'est surtout pour souligner l'aspect limitatif. Parfois j'aimerais qu'on porte moins attention à la matière. Et à l'esprit. Je suis une personne très lunatique, qui me fait des idées, des scénarios. Avant c'était problématique, je vivais des malaises par rapport à ça, il y avait trop d'information dans ma tête, je cherchais constamment à faire de l'ordre, j'y accordais trop d'importance. J'avais étrangement l'impression que seul-e-s les personnes les plus intelligent-e-s et les plus doué-e-s avaient un gage de réussite. Le voyage apporte une grande conscientisation, entre autres sur les répercussions de ces idées sur le corps. Aujourd'hui je questionne la relation que j'entretiens avec mon corps et c'est désormais là que va mon attention.
Mais je ne pense pas que la photographie ait vraiment joué un rôle là-dedans, bien que c'est intéressant de vivre une transition avec le support d'une œuvre. La photographie c'est très physique comme procédé : la lumière qui frappe un objet qui est sensible à celle-ci – il ira jusqu'à en brûler, pour finalement créer un image. N'en demeure que ce n'est pas très ressenti comme médium. De manière symbolique, ça aide à assimiler des choses, surtout avec la photographie analogique : c'est moi qui développe mes films, et cela représente un long procédé – j'ai pris 6 mois pour développer les photos issues de ce voyage – donc tu as le temps de te revoir, de te reconsidérer.
RÉCIT NOMADE : Peux-tu nous parler du livre, qui a dû se présenter à toi seulement suite au voyage... Comme acte de mémoire, pour honorer la traversée. Mais comment la matière du livre (papier, mise en page, pochette, bâton d'encens...) te permettait elle-même de revisiter ton histoire en Colombie-Britannique, de lui rester fidèle? Ou encore, de tirer certaines conclusions?
MARC-ANDRÉ : La matérialité du livre représentait certainement pour moi l'apogée du projet. C'était une grande satisfaction, car habituellement j'ai un gros handicap concernant la continuation de mes projets. Le fait d'avoir porté Il y a une entrée jusque-là, ça m'a finalement permis de faire le vide.
Et, oui, cette œuvre représente un hommage, je ramène d'ailleurs l'odeur de la forêt avec le bâton d'encens au cèdre. Le livre photo équivaut à une médiation, et pour y disposer le lecteur ou la lectrice, je tenais à ce qu'il y ait une relation physique plus investie. Qu'on entre dans la forêt en extirpant son contenu (comme le livre qu'il faut sortir de sa pochette) et qu'on retrouve l'odeur, stimulant les souvenirs.
RÉCIT NOMADE : Qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi dans l'expérience du nomadisme? Ce que tu souhaiterais ne jamais oublier, disons, dans ce mouvement.
MARC-ANDRÉ : Le mindset du voyage. De te retrouver là, en proie au magnétisme, livré à ton instinct. À la bête. La bête, je veux dire, la grosse vie qui t'avale. Il n'y a plus rien de structuré. Le fait de ne plus avoir d'obligations, de job, etc. C'est ce que j'ai ramené ici, et que je souhaite garder : le perpétuel voyage.
RÉCIT NOMADE : Si tu penses au prochain voyage que tu souhaiterais faire... comment intégrerais-tu cette fois le volet artistique? Et vers quel média pencherais-tu – la photographie, toujours?
MARC-ANDRÉ : La photographie, oui. Mais cette fois j'emmènerais ma guitare avec moi, car ça aide à faire apparaître certaines choses devant toi, à les faire agir en quelque sorte, plus rapidement et plus physiquement. Ce sont là mes deux polarités (guitare et caméra) je crois.
1 Yvon Rivard. Une idée simple. Montréal : Boréal. 2010. p.47.
2Présentation, traduction et notes de Guy Ménard, dans : Edward I. Bailey. La religion implicite. Une introduction.
Montréal : Liber. 2006. p.39
Marc-André Dupaul, Il y a une entrée, auto-édition, 2015, 32p.
marcandredupaul.com