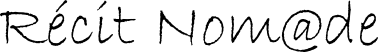Publié le 10/12/2015 - 21:42
Mes yeux sont clos. J’oublie tout, jusqu’à mon être, et me laisse envelopper dans ce silence qui n’en est pas un. Assise en tailleur au milieu de nulle part, j’ai l’impression de ressentir le tout pour la première fois. A droite je perçois le vent doux sur le fleuve majestueux ; ce dernier est tellement grand qu’il semble être un océan. J’entends. J’écoute.
Le claquement des vagues, milliards de gouttelettes se jetant les unes contre les autres, en dévisageant l’étendue foncée, sortie de sa langueur il y a peu. Un bateau ? Un vrombissement de moteur, à moins que la seule grandeur éclate et retentisse jusqu’à mon timpant.
Je capte des râles. Peut-être est-ce un phoque qui baille au réveil - il est tôt après tout- je ne le saurais jamais, je n’en ai jamais aperçu un, et le seul cri que je me sois imaginé de sa part ressemblait à peu près à « raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ». C’est drôle, dans cet espace sans hommes il me semble entendre des voix, lointaines, presque inaudibles, comme des chants de sirènes.
D’un rebond léger je me concentre sur le côté gauche de mon corps ; je suis légèrement penchée, et je me permets d’ouvrir les yeux un instant seulement. Je les referme.
Des oiseaux croassent ; je suis persuadée qu’il s’agit de corneilles, ou de corbeaux. N’est-ce pas la même chose après tout ? Pour nous, citadins aveugles et sourds, de simples oiseaux aux ailes de jais, des oiseaux de malheur. Une poignée d’aigles noirs jacassant et hurlant autour d’une piteuse proie.
Dans mon monde, je les déteste. Ici pourtant, je leur porte une attention toute particulière ; sur une île tout le monde est fasciné par le bord de l’eau, et moi, imbécile heureuse, j’écoute les grosses corneilles babillardes.
Plus près j’entends des mouettes, ou des goélands. Quelle ignorante je fais : quelle incapable qui ne saurait reconnaitre un oiseau d’un autre. Ah la vie citadine !
Les cris de la corneille sont réguliers : « croa, croa, croa, croa ! » Elle doit appeler quelqu’un.
Les mouettes sont nombreuses, et bavardes elles aussi. « Pfui, pfui, pfui, pfui, pfuiiii ! » La marée est basse, et elles en profitent : les algues multicolores jonchent le sol humide. Du sable, des rochers, des cailloux, de l’eau. L’eau a le goût de la mer. Me voilà surprise de la saveur du fleuve. De l’eau, des moules, des algues. Des algues qui craquent, des algues qui glissent, des algues vertes, des algues marron. « Tiens, ça ressemble à une touffe de cheveux ; les mêmes que les miens ! » Je suis donc un élément marin, aux cheveux d’algues et à l’odeur saline.
On dirait des choux, parfois des pattes de poulet, aux extrémités boursoufflées et pointues. De la salade sinon : laitue vert fluo ou batavia violine. Certaines ont l’air d’anémones mais elles sont immobiles ; les laissées pour compte de l’univers, jetées au bord du rivage. Les exclues de la société marine. Le soleil lui-même ne peut plus rien pour elles.
L’algue ça sent.
Dans mon monde je déteste ça. Ici pourtant elle semble me fasciner d’une manière exceptionnelle.
Une odeur salée, une odeur puissante, quelque chose qui brûle les narines et descend jusqu’à la gorge. Sous la chaleur estivale c’est comme le festival de la moule morte ; déflagration ultime, pourriture amplifiée sous 40°C. Merci. Ici, l’été est parti, il a tiré sa révérence depuis longtemps, alors l’odeur n’est pas incommodante. Pas dérangeante, pas dégoutante, pas écœurante.
J’aime la fragrance des algues. Qui l’eut cru ? Je suis dans un autre monde, ça explique tout.
Les mouettes continuent leur danse infernale autour de moi ; je suis devenue transparente, comme inhérente au paysage. Elles ne me portent aucune attention ; elles ne me remarquent peut-être même pas. Elles m’ignorent et vaquent à leurs occupations. Moi je les vois, et c’est comme un spectacle. La mer s’est retirée, c’est jour de marché : les créatures bedonnantes font leurs courses parmi les algues et les rochers. La pêche semble bonne.
« Croa, croa, croa, croa ! »
Les corneilles n’arrêtent pas. Je ne peux les faire taire. Elles sont puissantes, et la seule chose qu’il me reste à faire c’est les écouter chanter et cancaner.
« Clap, clap, clap ». Les petites pattes bien fermes tassent le sable encore immergé ; elles le pétrissent et font des clapotis sur l’eau.
Les sonorités sont nombreuses. Symphonie de tout sauf de moi-même. C’est agréable, c’est comme si le monde minuscule avait pris le dessus depuis longtemps sur l’incommodité de la taille humaine.
Je respire le moins possible pour percevoir chacune des vibrations. De temps à autre une mouette doit sentir quelque chose bouger ; elle plonge son bec dans l’eau froide : un ver, un mollusque, un coquillage, un végétal, un animal ? Je ne le sais même pas. Ignorance ultime. Vive la vie citadine.
Elle est plus forte que moi, je le sais, je le sens. Elle m’enivre, cette nature immense, et je prie pour qu’aucun mangeur de pain ne vienne la fouler, la toucher, la transformer.
J’ai l’air d’être l’élément de trop dans cette harmonie éternelle. La fausse note, la couleur criarde, l’odeur artificielle et pestilentielle. Je suis le monstre ici.
Mon derrière est froid et mes pieds engourdis : je me trouve dans une position assez inconfortable finalement. J’essaie d’oublier mon corps, cet idiot qui me rappelle sans arrêt à l’ordre, et de devenir légère. Légère et transparente. Je suis un esprit. Je suis mon esprit. Je suis fragile et ignorante. Il me reste du chemin à parcourir encore.