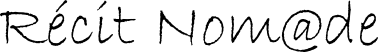Publié le 03/01/2017 - 16:17

Source de l'image : Max Pixel, récupérée au http://maxpixel.freegreatpicture.com/Forest-Mood-Nature-Autumn-Trees-Fog....
Géopoétique du voyage : Reprendre racine
Cet automne, j’ai abordé le trajet intellectuel proposé par Récit Nomade à partir de questions chères à ma démarche, et dont je n’ai jamais pu me défaire. Ces interrogations sur l’état du monde contemporain, sur le rôle de l’écrivain à l’heure de la crise écologique, tournaient sans cesse dans ma tête, ressurgissaient au fil des lectures, des rencontres, des voyages, des marches.
Comment peut-on penser le récit de voyage autrement que comme un simple rapport de déplacements, d’anecdotes ? Comment, par ce genre littéraire distinct, l’écrivain peut-il provoquer un choc, un mouvement de conscience, une réflexion existentielle profonde chez le lecteur ? Comment peut-il faire naître chez ce dernier un rapport au monde renouvelé, plus humain, plus sensible ? Comment peut-il témoigner d’une relation riche et respectueuse, à la fois sensorielle, intellectuelle et affective, en tout temps réciproque, avec le territoire parcouru ?
Ces questions, je les ai d’abord abordées par le biais de la géopoétique, un mouvement interdisciplinaire fondé par Kenneth White et auquel prennent part, depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années, des artistes et des chercheurs de partout. White appelle son approche littéraire le champ du grand travail, puisqu’il vise non seulement l’émergence d’une théorie de la recherche et de la création, mais surtout le fondement d’une nouvelle culture, d’une nouvelle base commune où pourrait s’épanouir l’humain contemporain. Le socle de cette culture devrait être, selon lui, « la terre même, sur laquelle nous tentons de vivre, et sans laquelle il n’y a pas de monde vivable »[1]. Une culture planétaire plaçant au centre de ses préoccupations la terre (le terme « terre », en géopoétique, dérive du mot anglais land et ne fait donc pas seulement allusion à la planète Terre, mais au sol, au territoire, au terroir, aux cultures, justement), plutôt que le profit, l’efficacité, la productivité, entre autres, représenterait un nouveau terreau fertile pour l’esprit et la pensée, au sein duquel l’humain pourrait reprendre racines, évoluer, se développer tant spirituellement qu’intellectuellement, retrouver un sens à son existence dans un monde qui, trop souvent, prend les apparences d’un « immonde »[2]. Pour que cette culture puisse voir le jour, White propose de « développer un rapport sensible et intelligent à la terre en élaborant une nouvelle manière d’envisager les rapports entre les disciplines artistiques et scientifiques »[3], notamment par le décloisonnement et l’interrelation des différents champs de connaissances (sciences naturelles, philosophie, poétique, géographie, etc.). De cette manière, les géopoéticiens pourraient enrichir le rapport entre l’humain et la terre et « rendre au champ de l’être humain le maximum d’être : de présence, de perception, de compréhension, d’expression, de communication »[4]. Enfin, la géopoétique est une résistance, une « critique radicale »[5] de nos sociétés occidentales. Elle oppose la lenteur à l’efficacité, la sensibilité à la froideur, la poésie au calcul sec, le mystère à la bonne réponse, l’effacement de soi à l’égoïsme, le dépouillement au trop-plein. C’est depuis cet ancrage théorique de la création que je me suis lancé le défi d’ouvrir ma réflexion sur le voyage et sur l’état du monde à divers champs de connaissances, de la phénoménologie à la philosophie, en passant par l’écologie, la neuroscience, la géographie et la littérature. De ma pensée bouillonnante, de mon esprit en constante migrance[6], sont issus les quelques fragments qui suivent. Détachés, mais toujours en relation. Tissés les uns aux autres par un désir profond d’unité, de réunion. Un archipel réflexif (inspiré de sa configuration dans la pensée d’Édouard Glissant, tel que rapportée par Rachel Bouvet[7]), constitué de milliers d’îles éparses, déposées au hasard au fil des eaux. Chaque îlot est isolé, mais les habitants communiquent, voyagent de manière naturelle d’une plage à une autre, s’y échangent des ressources uniques. Imaginons-les isolés ensemble.
***
Expérience géopoétique à l’Isle-aux-Grues
C’est lors du court voyage à l’Isle-aux-Grues organisé par Récit Nomade à la fin septembre que j’ai pu non plus réfléchir, mais vivre l’approche géopoétique, en ressentir les effets sur l’expérience sensible du voyage, sur le rapport intensifié au lieu. Cet instant unique, court mais d’une grande densité, faisant appel à mon être entier, à mon intellect comme à mes sens, à ma nostalgie du passé comme à mon vécu de l’instant, à ma sensibilité artistique comme à ma rationalité, a eu l’effet de « densifier [mon] rapport au monde »[8], ainsi que celui de transformer ce lieu qui n’était à mes yeux, 24h plus tôt, qu’une masse rocailleuse échouée au milieu du St-Laurent, gisant inerte sur une carte routière. Mais venons-en au cœur du sujet : la rencontre de Marc Séguin à l’Isle-aux-Grues comme vecteur d’expérience géopoétique concrète.
Au terme d’un parcours de vélo de près d’une heure, entourés par la seule nature sauvage de l’île, bercés par l’environnement sonore organique (à mille lieux de celui des villes), au beau milieu d’une section de l’île pratiquement déserte (outre pour les milliers d’oies qui en sillonnaient les berges), nous nous présentons à l’heure prévue chez M. Séguin, dans la maison autrefois occupée par le peintre Jean-Paul Riopelle. Commence alors la visite des lieux. Nous parcourons l’atelier où Riopelle a produit la célèbre fresque « L’Hommage à Rosa Luxembourg »[9], longue de plus de quarante mètres, créée en bombant des dizaines d’oies et autres espèces d’oiseaux chassés sur place. Au sol, des empreintes identiques à celles visibles sur cette œuvre ornent le plancher, témoignent d’une pratique, d’une vie consacrées à l’art et à la nature. Puis, M. Séguin nous instruit sur l’unicité géologique, historique, anthropologique, écologique de l’archipel de l’Isle-aux-Grues. Il nous explique que ce mince territoire était d’abord peuplé par des tribus amérindiennes qui y cultivaient les terres, rendues très fertiles par les alluvions déposées chaque printemps par la hausse des eaux du fleuve sur les battures[10]. Il ajoute que c’est en raison de ces plantations variées (incluant notamment de grandes étendues de céréales diverses et de maïs), héritées de l’agriculture amérindienne et dont raffolent les oies, que ces dernières s’arrêtent depuis des centaines d’années sur les battures de l’archipel durant leur parcours migratoire vers les États-Unis. Il nous raconte ensuite que les premiers colons canadiens français à s’y être installés au 17ème siècle, en plus de devoir vivre dans des conditions insulaires extrêmement précaires (difficulté d’accès aux vivres, aux soins, aux biens de consommation, notamment) circulaient l’hiver en canots à glace[11], des embarcations imposantes qu’ils devaient pousser sur de larges distances dans des conditions glaciales, pour des activités aussi simples que la livraison du courrier. Il précise que Riopelle a d’ailleurs créé un canot à glace orné de traces du milieu naturel de l’île, imprimées par le bombage à l’aérosol d’oies et d’essences de plantes trouvées sur place[12]. Ensuite, il nous dévoile que l’horizon, le point de vue qui s’étend devant nous, est unique au monde, car de la pointe de l’Île-aux-Oies (l’île la plus à l’est de l’archipel) on peut embrasser du regard deux formations géologiques différentes, opposées de part et d’autres du St-Laurent : le Bouclier Canadien, territoire rocailleux au relief très prononcé, sur la rive nord, et les Basses-terres du St-Laurent, pratiquement plates, terres fertiles d’agriculture, sur la rive sud. Cette situation s’explique par le fait que l’archipel se trouve à la frontière de ces deux immenses ensembles rocheux, qu’elle trône directement au-dessus d’une faille géologique. Après cet exposé improvisé, je m’arrête, savoure le silence, contemple par la fenêtre de la maisonnette le paysage qui se met à vibrer, à pulser. Le souffle coupé, je me sens soudain non plus sur, mais parmi l’Île-aux-Oies, replacé au milieu d’un organisme au cœur battant. Un carrefour vivant. Les cheveux soufflés par les voiliers d’oies, les pieds plantés dans le terreau fertile des battures, la peau inondée par les alluvions fluviales, la tête, le cœur soulevés par les images mentales de l’œuvre de Riopelle, je suis saisi par l’intense sensation, libératrice, de faire partie d’un ensemble plus grand que moi, de m’y dissoudre, d’appartenir à ce lieu (car ce n’est certainement pas lui qui m’appartient), une terre complexe, traversée de millions de mouvements insondables, dont l’occupation (par les animaux comme par les hommes) dépend de forces (le fleuve, le vent, les plaques tectoniques) hors du contrôle humain. Le rapport au lieu était, en quelques heures seulement, devenu signifiant. Sacré. À ce moment, j’ai compris que la géopoétique plus qu’une simple théorie, était une manière d’être au monde, un acte de lecture, de perception de l’immensité.
***
Exercice : Définition de culture
Question centrale : « La question de la culture est la question primordiale »[13].
Objectif : Refonder une culture intelligente, sensible, menant à une réunion humains-nature.
Exercice : Définir le mot culture (devenu aujourd’hui si galvaudé qu’on le perd de vue).
Culture, selon le Larousse : « 1. Enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. 2 : Connaissances dans un domaine particulier »[14].
Culture, telle que définie par Kenneth White :
Pour qu’il y ait culture au sens fort du mot, il faut que soit présent dans les esprits d’un groupe un ensemble de motifs et de motivations : lignes de force, « formes maîtresses », comme disait Montaigne, et cela, non au niveau du plus bas dénominateur commun (« sport », « loisirs », « distractions »), mais à un niveau qui invite et qui incite la personne sociale à se travailler, à déployer ses énergies dans un espace exigeant. Là est la source d’une véritable jouissance intellectuelle et existentielle »[15].
Culture, ma définition personnelle [clin d’œil vers le Professeur Cornett]) : Activité (mentale, physique, requérant un mouvement) unissant l’homme et la terre, impliquant un travail, un sacrifice, une fatigue. De ce labeur (re)naît une fertilité, un développement (comme on développe un cadeau, on dévoile un potentiel), un fruit que l’on peut récolter, savourer, offrir. La culture tout court, comme l’agriculture, nourrit, réunit, se partage, demande effort, dévouement, amour.
Mots-clés récoltés durant cet exercice mental : enrichissement, intellectuel, connaissances, motivations, lignes de force, se travailler, déployer, espace exigeant, pratique fondatrice, partage.
***
Destitution et humilité
« Si l’homme moderne dit : « Je suis, et le monde est à moi », le géopoéticien dit : « Je suis au monde – j’écoute, je regarde ; je ne suis pas une identité, je suis un jeu d’énergies, un réseau de facultés. » ».[16] Appartenir au monde, c’est accepter d’être possédé par lui. C’est se placer dans une posture d’ouverture, d’accueil. C’est, surtout, se destituer du rôle dominant accordé à l’humain depuis Descartes. Descendre du piédestal d’une humanité imbue d’elle-même, de son intelligence (au demeurant incomplète, car totalement déconnectée du vivant, du mystère, de l’imprévu, du vécu). Pour pratiquer la géopoétique, l’on doit redescendre au niveau des choses, se défaire de sa prétention de supériorité, du poids de ses connaissances et de la culture occidentale moderne, cause principale de la « séparation totale de l’être humain et de la terre »[17]. Pour transformer son regard, atteindre l’humilité, la gratitude, nécessaires à retisser le lien ténu qui relie l’homme à la nature, il doit enfin expérimenter « ce que c’est d’être petit »[18]. Pour ce faire, il étudie la terre, comprend son incommensurable complexité, mû par la volonté de mieux la sentir, la percevoir, la lire, l’entendre[19]. Son esprit voyage, mais toujours vers la terre, qu’il respecte, chérit, écoute.
***
Répétition et apathie
Piégé en notre siècle dans des boîtes préfabriquées, de petits compartiments où la pensée est classée par fonction, puis dirigée, instrumentalisée, guidée selon des tracés précis, comme le sont les réglages d’une horloge, l’humain se trouve, au jour le jour (et qu’est-ce qu’un jour, au 21ème siècle, si ce n’est un outil pour accomplir un travail ?), à arpenter les mêmes lieux, souvent de la même manière (Attitude « x » pour réaliser objectif « y » en vue de but « z »). Sa vie, il ne l’éprouve plus, il la survole, la subit selon des règles dont il n’est pas le maître. L’humain devient paralysé, contrôlé par le hasard du sort. Un pion de plastique sur une planche de jeu. [Rouler les dés. Avancer du nombre de cases indiqué. Piger une carte. Suivre les instructions. Attendre le prochain tour. Effectuer l’action suivante. Répéter.] Mais où est donc passé, dans ce jeu où l’aboutissement est la victoire (de quoi, on ne le sait souvent même plus …) le processus, cet intermède, cette vie ignorée, située entre le point A et le point B ? Que reste-t-il du chemin (car l’humain, contrairement au pion, ne peut pas sauter de la case 1 à 12 en un claquement de dés), ce parcours (physique et mental) fondamental que l’on oublie, submergés, noyés par l’habitude, mus par le désir (un désir qui ne naît pas de nous, mais qu’on nous sert, tiède comme de la purée néolibérale dans un CHSLD) d’être efficaces, rapides, productifs (que voulez-vous dire par accomplis ?). La répétition des mêmes mouvements (du corps comme de l’esprit), des mêmes opérations (tant au travail que dans le quotidien), des mêmes discussions (insérer ici commentaire météo, blague à la saveur du mois, référence banale à l’actualité), des mêmes trajets, reproduits au geste près, des milliers et des milliers et des millions de fois, hypnotise l’humain, l’engourdit jusqu’à ce qu’il ne soit plus que sommeil, apathie, insensibilité, que l’on puisse guider ses pas, sa route, sans qu’il n’en soit conscient. Pourtant, « « seule la route connaît le secret », ou plus secrètement « seule la route connaît le chemin » »[20]. Pour combattre l’apathie, la paralysie, l’inconscience il nous faut revenir au processus (plutôt que de fixer nos yeux sur l’objectif et ainsi oublier de vivre le voyage [enjoy the ride, disent les Anglais]), à l’état liminaire[21]. Ce sont ces passages, ces entre-deux, qui nous permettent de nous défaire de nos origines, de mettre nos certitudes à l’épreuve, de changer de direction quand plus rien ne semble faire de sens. Drôle, comme le mot direction, en anglais, signifie entre autres « instructions, consignes »[22]. Et si on déviait ? Et si on désobéissait ?
Dans le bon sens
Le voyage, s’il implique un changement de direction, de trajectoire, ne doit jamais perdre son sens, devenir une fuite aveugle, insignifiante. Insensée. Si on fait bien de perdre le nord, il faut toutefois le perdre dans la bonne direction, à contre-pied de la société mortifère dans laquelle nous ne vivons que par petites bouffées, où l’humain ne trouve plus sa place.
«On ne mesure pas la qualité
De la fuite à la distance
L’important c’est juste de fuir
Dans le bon sens »[23].
***
Décloisonnement
La géopoétique vise à décloisonner, à ouvrir les cellules hermétiques dont sont prisonniers les champs artistique et scientifique, à leur permettre de se rencontrer, d’échanger, de s’entremêler, de se contaminer, de se métisser jusqu’à changer de visage (et de regards). Mais le voyage n’est-il pas, par sa nature inhabituelle, imprévue, parfois dangereuse, source de décloisonnement de l’être (comprendre ici décloisonner comme « retirer les cloisons », à la fois mentales et concrètes, qui encadrent le vécu de l’homme occidental contemporain, le maintiennent en « sécurité ») ? N’est-il pas source de libération et, du même coup, d’altération du corps comme de l’esprit ? Une douce expulsion de l’être hors des paramètres qui régissent au millimètre près son vécu ordinaire ? Nicolas Bouvier affirme que le voyage peut renouveler la perception, le rapport au monde, qu’il permet « de gagner par déracinement, disponibilité, exposition »[24] un sentiment d’habiter le monde, de s’habiter soi-même plus pleinement. Ce décloisonnement du voyageur, placé en dehors des repères qui le définissent habituellement, rappelle la phase de séparation vécue dans le phénomène rituel tel que dépeint par Turner[25]. Le voyageur se défait de ses ancrages (culturels, sociaux, identitaires) et de ses repères, se voit retirer le plein contrôle de son existence (le voyage n’est-il pas forcément parsemé d’imprévus, de détours, de perte?) est replacé en position de vulnérabilité, à la merci de l’altérité qu’il rencontre, qui le traversera bientôt pour y laisser des marques indélébiles. Perte de repères, de contrôle, donc. Or, comme le souligne Bouvier, ce qu’il perd, le voyageur le récupère, le regagne par l’expérience de ce dépouillement, de cette nudité, qui enjoignent l’individu à s’ouvrir, à accueillir ce qui vient, à être disponible à ce qui l’entoure et, pour une fois, à être touché, à se laisser modifier, changer, par ce qui ne l’effleure plus mais le pénètre. La cloison séparant l’humain de son vécu sensible est abattue par le voyage, par cet état de fragilité qui dégage soudain un nouvel horizon de pensée, insoupçonné parce que jusqu’alors inaperçu.
***
White et la « dérive des consciences »
Une fois ouvert devant lui un nouvel espace, en lui un nouveau regard, libre de penser, de réfléchir, de ressentir, l’humain assiste, dehors comme dedans, à une remise en mouvement des mécanismes organiques, depuis longtemps oubliés, enfouis dans une part obscure de son être à laquelle il n’avait plus accès, captif d’une routine fade, indolore et insipide. La poétique dont parle Kenneth White n’est pas un genre, mais une « dynamique fondamentale de la pensée »[26] qui aurait la capacité de renouveler la perception. Selon Serge Velay, la géopoétique réaffirme « la vocation, l’ « efficace de la littérature », comme modalité privilégiée d’ouverture au monde, et comme moyen de sa transformation »[27]. Or, même en postulant que ce soit possible de changer le rapport au monde de l’être humain par la création, une question demeure et, bien que courte, il s’agit de la plus complexe : comment ? Pour Kenneth White, la réponse est dans la pratique essentielle du dehors, du paysage, du territoire, que le poète-géographe est invité à parcourir, ressentir, percevoir, avec sensibilité et intelligence. D’ailleurs, le voyage et la rencontre avec l’altérité, par laquelle peuvent voyager corps et pensée, sont centrales à l’approche géopoétique. Selon White, le choc intérieur né du contact avec l’inconnu, l’autre, l’ailleurs, le dehors, déclenche chez l’individu une « dérive des consciences »[28]. Ce mouvement profond de l’être, qui rappelle celui des plaques tectoniques, lent, presque insondable, mais d’une puissance sans nom, réduit la distance que l’humain ressent par rapport à la terre, resserre et intensifie sa relation avec elle (une relation qui, pour le géopoéticien, se reflètera forcément dans ses œuvres). C’est donc dire qu’au contraire de la dérive des continents, qui a lentement divisé l’ancienne Pangée[29], la dérive des consciences vise plutôt à réunir les êtres humains entre eux, puis à retisser leur relation à la nature par un rapport au monde densifié, enrichi par le choc de la rencontre avec la poésie, la science et la philosophie, ces champs de connaissances qui font office de continents, de pays à visiter et permettent de voyager par l’esprit hors des limites de nos conceptions habituelles du monde.
***
Ouellet et la migrance
Cette idée de la dérive des consciences, primordiale en géopoétique, trouve écho chez Pierre Ouellet, qui avance que l’esprit humain se remet en mouvement, migre, au contact de l’altérité. Ce qu’il définit comme la « migrance »[30] est une forme de migration n’ayant rien à voir avec la détresse humaine vécue par les migrants syriens, par exemple. Elle fait référence non pas à une pensée déracinée, égarée (comme une girouette agitée par des vents contraires), privée de sens et d’un ancrage identitaire sans lequel elle se trouve démunie, mais plutôt comme une mobilité salvatrice de l’être, un mouvement puissant et instinctif offrant une « chance inespérée d’une nouvelle définition de l’homme »[31]. Le voyage, puisqu’il affecte l’individu tant dans sa relation avec son environnement qu’avec lui-même, permet cette migrance, défait le lien originaire (l’ancrage identitaire issu du passé) pour le « renouer chaque fois en un nouveau destin, un autre devenir qui est aussi un devenir autre »[32]. Le voyage et la géopoétique, en tant que forces irrépressibles de l’être remis en marche, pourraient donc bel et bien s’avérer sources de renouveau, comme le souhaitaient White et Velay. François Zourabichvili écrivait d’ailleurs, à propos de l’idée deleuzienne du devenir, que cela « signifie que les données les plus familières de la vie ont changé de sens, ou que nous n’entretenons plus les mêmes rapports avec les éléments coutumiers de notre existence : l’ensemble est rejoué autrement »[33].
Cela me rappelle, dans un autre ordre d’idées (appliquons le décloisonnement prêché par la géopoétique, laissons dévier la pensée rectiligne) la théorie quantique, qui « envisage le réel de manière dynamique »[34], affirme que « l’univers est basé sur des potentiels »[35] et que les particules qui composent un objet « peuvent en composer un, puis un autre et se transformer sans cesse »[36]. Et si, par le biais du voyage, comme par une approche géopoétique de la création, les humains, trop souvent campés dans leur identité fixe (M « X », 50 ans, avocat, père de deux) pouvaient migrer vers de nouveaux devenir ? Et si le choc ébranlait les pièces de nos casse-têtes identitaires ? Et si elles retrouvaient soudain, comme des particules remises en mouvement, leur mobilité, leur malléabilité, et pouvaient être réorganisées en nous pour nous rebâtir autrement ?
***
Remettre la géographie et la carte en mouvement
La mappemonde, offerte à l’étude des géographes dans une vue en contre-plongée de la planète complète, divisée en fuseaux horaires (et quoi de plus humainement construit que le concept de temps ?) est à mon avis la plus belle démonstration que l’humain en est venu à se croire divin, maître des éléments, au-dessus de la terre, embrassant de ses yeux mécaniques (semblables à ceux d’un microscope), froids et analytiques, l’entièreté du territoire, organisé et classé en un seul plan informé, scientifique et calculé. À l’ère de Google Maps, le monde entier est cartographié. Même le plus minuscule des villages peut être repéré et même arpenté par des images à 360 degrés en posant un symbolique être humain dans la carte (à quoi bon y poser les pieds quand on peut y poser les yeux ? Comment peut-on alors prétendre, par la littérature, la poésie, pouvoir découvrir, dévoiler le monde, s’il est maintenant entièrement connu ? Parce que s’il est représenté par des plans bidimensionnels (en surface), cet espace immense que nous offre la Terre n’est pas véritablement perçu, senti, vécu, dans un voyage virtuel totalement aseptisé, dénué de l’expérience sensorielle, humaine, du territoire visité. J’aime beaucoup ces mots de Bouvet, qui affirme que l’enjeu du récit de voyage « ne consiste plus à faire découvrir de nouvelles terres, mais à en déplier les multiples facettes »[37]. La géopoétique, c’est justement ce qui déplie un lieu, ce qui lui rend toutes ses dimensions.
Sur les dimensions d'espace et de temps, nous disposons d'un bon nombre d'études sociologiques bourrées de statistiques, de figures, de graphiques et le reste. Mais cela ne suffit pas s'il manque des paramètres essentiels. L'air que nous respirons, le plafond que nous ne pouvons toucher, la lumière fluctuante et l'espace même où nous nous déplaçons sont autant de dimensions cachées, qui ne le sont pourtant pas pour l’œil qui les cherche.[38]
Le rôle du poète-géographe est de « décentrer [son] regard »[39] pour percevoir (ou encore de percer/pour/ voir, pour se « débarrasser des filtres qui composent la manière habituelle de voir les choses »[40]) ces « paramètres essentiels » de l’espace dont parle Dansereau, des paramètres à mettre au jour non plus par sa seule rationalité, mais par une approche globale, informée, intelligente, sensible surtout, libre de s’égarer dans l’expérience, suivant une attitude instinctive le projetant hors des cadres restreints le limitant d’ordinaire. Poser un regard renouvelé, plus tendre et plus intelligent (de par ses connaissances de divers ordres, botanique, par exemple), à l’extérieur des quadrillés cartésiens (inhumains, aseptisés), sur le monde qui nous entoure, voilà l’idée. L’écriture géopoétique vise à redonner une dimension plus vivante et organique à l’espace, à replacer l’être humain « dans une perspective relationnelle »[41] plus équitable et réciproque avec son environnement.
***
La poésie comme critique radicale
David Abram rappelle qu’« [e]n dépit de tous nos artefacts mécaniques, le monde où nous nous trouvons avant de commencer à calculer et à mesurer n’est pas un objet mécanique inerte mais un milieu vivant, un paysage dynamique et ouvert, sujet à ses propres humeurs et métamorphoses »[42]. Par sa tentative de dévoiler la vie qui grouille déjà sous nos yeux, par son engagement à dégager un « espace existentiel »[43] plus riche et par une écriture attentive au vivant au muet et au dissimulé (à la faune, à la flore, au relief, aux particularités géologiques du territoire, ainsi qu’aux odeurs, aux petits éclats de beautés et de puissance qui témoignent de la résilience de la nature, mais aussi aux horreurs, à la destruction, aux cicatrices qui parcourent le territoire), la géopoétique se pose comme une critique radicale de la société occidentale. Elle met en lumière non seulement l’insensibilité de notre relation à la nature, mais aussi l’impuissance absolue de l’humain à maîtriser cette dernière. Au lieu de condamner directement la société, source d’injustices, la géopoétique revalorise les lieux, dépoussière ce qu’il reste de délicatesse, de fragilité, de beauté cachée. Elle engendre un renouveau par une inattendue et gratuite tendresse pour l’inaperçu (ce que nos yeux ne voient plus, voilés par les écrans du quotidien, du néolibéralisme, de la consommation, de la vitesse), et propose par ses représentations inusitées de nouvelles perspectives existentielles, sensibles et intelligentes, en communion avec la nature. Elle repeuple le morne, le plat de la géographie cartésienne, parsème notre « vision intérieure »[44] du monde (intimement liée au rapport qu’on entretient avec ce dernier, respectueux si cette vision est tendre, cruelle si le rapport est appauvri, froid et calculateur) de plantes, d’oiseaux, de boue, de nuages, de lumière, de gens qui courent, de courants d’air, de reliefs accidentés, d’accidents, de courbes, d’inconnu, d’insondable, d’erreurs, d’errance. D’esprit. De vie.
***
Stationnement à condos ?
Bien que cela puisse paraître commune poésie, Bertrand Lévy affirme que « la géopoétique ne parle pas que des pierres, du sable et des fleurs, de la glace, du soleil et des ruines, elle parle aussi des retrouvailles de l’homme avec lui-même […], elle est un humanisme géographique »[45]. À propos de cet humanisme géographique, Eric Dardel écrit que la connaissance géographique « a pour objet de mettre au clair ces signes, ce que la Terre révèle à l’homme sur sa condition humaine et son destin »[46]. En somme, le géopoéticien, en se jouant consciemment, mais surtout autrement (sensiblement, poétiquement), des instruments de la raison (connaissances et compétences géographiques, scientifiques, chimiques, botaniques, …) ainsi que de ceux de son intuition (instinct créatif), redonne par sa lecture de la terre une intensité, un souffle, une vie, au monde que les sociétés contemporaines tentent de désâmer[47], de présenter comme un vulgaire stationnement à condos ou un entrepôt débordant de ressources à exploiter, à piller.
***
Réduction, banalisation, destruction
Quand réaliserons-nous que cette réduction (quoi de plus réducteur qu’une carte géographique, qu’une équation, qu’un organigramme, pour représenter le vaste espace terrestre) opérée par la raison froide et chirurgicale (qui divise le monde pour mieux le maîtriser, mais ce faisant le déracine) mène à une vision intérieure tiède, sèche et infertile du monde, qui mène à la banalisation de sa destruction par l’activité humaine. J’aimerais, par la géopoétique, extraire mon lecteur du territoire confiné, limité, de la raison objective, pour le prolonger dans l’espace infini de l’imaginaire, dans le vécu enraciné, incarné, polysensoriel, émotif du monde qui en récupère sa vastitude, ses infinis dimensions, son souffle, ses dangers, ses forces et son immuable certitude. Par mes mots, véhiculer un sentiment de plénitude, jailli de l’expérience intime, subtile, recueillie, sensible, de la terre telle qu’elle s’offre à celui qui s’y abandonne en pleine conscience. Je souhaite, comme le dit White, me situer dans l’énorme.
« Le géopoéticien se situe d’emblée dans l’énorme. J’entends cela d’abord dans le sens qualitatif, encyclopédique (je ne suis pas contre le quantitatif, à condition que l’accompagne la force capable de le charrier), ensuite, dans le sens d’exceptionnel, d’é-norme (en dehors des normes). En véhiculant énormément de matière, de matière terrestre, avec un sens élargi des choses et de l’être, la géopoétique ouvre un espace de culture, de pensée, de vie. En un mot, un monde »[48].
***
Habiter pour être habité
Avoir une approche géopoétique de l’existence humaine (et par ricochet, de la création), demande un « effort sur soi-même d’ouverture au monde »[49], une réflexion sur sa propre manière de l’habiter. Ce champ de recherche-création « invite à questionner le rapport entre l’homme et la terre, à ouvrir ses sens et son intellect à l’expérience qu’offre la vie sur terre et à susciter chez lui un sentiment de présence au monde »[50]. Sommes-nous réellement présents, activement connectés à la terre que nous habitons ? J’en doute. Interrogeons-nous notre expérience du territoire, du monde contemporain, de l’existence humaine ? Certainement, mais pas assez souvent, pas assez profondément. Heureusement, hors du contexte quotidien, le voyage suscite chez l’individu un éveil de l’esprit et des sens, offre un accès plus profondément enraciné au lieu où il se tient, qu’il prétend habiter, mais que trop souvent il survole sans s’y implanter, dans toutes ses dimensions sensorielles, de par la simple présence (de l’esprit tendu vers le monde), l’ouverture et la disponibilité du voyageur qui est venu expressément pour voir/vivre/ressentir/découvrir un endroit particulier. Cet état au monde, cette présence entière du géopoéticien lui permet d’« ancrer [s]a poétique dans l’existence»[51] (puisqu’elle prend racine dans son contact réel, physique, avec le paysage), de reprendre racines (par le corps comme par la pensée) dans un monde perçu à « hauteur d’hommes » [52], ni plus haut ni plus bas que cela. Et c’est là, à ce moment précis, qu’il se remet à habiter le monde qui, en retour, se remet à l’habiter, comme une douce obsession.
***
Double mouvement
« L'alternative est claire : creuser ou surplomber, approfondir ou s'envoler. Sinon les deux réunis, dans un va-et-vient sur l'axe vertical du lieu qu'on fouille, au centre, dans l'ici-bas, originaire et tellurique, et de l'espace qui s'ouvre, indéfini, là-haut, eschatologique et cosmique »[53]. La géopoétique, c’est justement ce champ des deux réunis, ce mouvement de va-et-vient, du corps comme de l’esprit, qui oscille entre le lieu occupé (ressenti par un sujet situé dans un endroit précis) et l’espace (gigantesque, que l’esprit peut imaginer sans jamais le percevoir directement) qui l’englobe[54]. C’est une attitude, un être au monde qui réunit l’unicité de l’expérience individuelle et la conscience globale (essentielle) de se savoir lié, appartenant à un ensemble bien plus large, bien plus puissant que soi et totalement hors de son contrôle. De cette conscience naît, presque inévitablement, une humilité salvatrice. Cette attitude est l’une des clés pour renverser l’état du monde, mais elle est trop souvent mise de côté, car les humains, en particulier les Occidentaux, se croient au-dessus du monde plutôt que parmi.
Mais si le géopoéticien a un parti pris pour le sol, la terre, la vie perçue à hauteur d’homme, cela signifie-t-il qu’il ne peut plus s’élever par l’esprit ? Qu’il ne peut plus accéder à des ensembles mentaux plus grands que lui ? Pas du tout, et c’est là toute la pertinence de cet extrait de Pierre Ouellet. Le mouvement mental est double, comme celui de l’arbre qui enfonce ses racines en profondeur pour mieux conquérir le ciel ensuite. Il s’agirait donc, pour celui qui cherche à renouveler son rapport au monde, à soi comme au cosmos, de ne pas craindre, d’abord, de s'enfoncer, de descendre en soi. L’individu en quête de sens creuse en lui-même non pas pour se terrer, pour se cacher dans les profondeurs du moi (et son obscurité), mais plutôt pour trouver le chemin, la voie ouverte lui permettant de traverser, de franchir cet isolement qui le sépare de lui-même, des autres humains, de la nature qui le porte. Cette traversée du moi lui sert non pas à se complaire dans son identité, mais plutôt à retrouver ce qui le lie au monde qui l’entoure, à permettre de s’extraire de cette solitude de l'homme contemporain. Ce dernier, croyant à tort flotter au-dessus de la terre, vit trop souvent déraciné (peut-être, d’ailleurs est-ce pour cela que la terre se dérobe sous ses pieds, comme dans un glissement de terrain en zone de coupe à blanc), détaché de soi, de l'autre, de la nature, du lieu précis qu'il prétend habiter et du monde plus large qui le porte, et doucement l'emporte.
***
Rupture
Dans ce mouvement de « va-et-vient » nous passons sans cesse du dedans au dehors – et inversement. Ce mouvement contradictoire est la preuve indubitable qu’il nous faut toujours l’événement soudain d’une rupture pour rompre l’attente, pour la mieux décevoir et pour raviver en nous, du même coup, la promesse brûlante d’un nouvel accord avec le monde.[55]
La géopoétique vient jeter ce regard inattendu, se lance hors des horizons d’attente dans une « lecture insoupçonnée »[56] du monde dans lequel on vit. De cette petite rupture, de cette déchirure dans le tissu trop uniforme de l’habit[ude], s’élève quelque chose comme un souffle, un espace, une liberté de ressentir, d’occuper pleinement l’espace à nouveau.
***
Effacement
« L’écriture, lorsqu’elle approche du « vrai texte » auquel elle devrait accéder, ressemble intimement au voyage parce que, comme lui, elle est une disparition. »[57] Le géopoéticien, mû par un désir d’humilité et de petitesse, se prête à l’exercice de la négativité de son être, il s’apprête à disparaître dans le vaste monde qu’il montre (sans explications ni rhétorique ni démonstration) dans ses œuvres. Il doit s’effacer pour laisser toute sa place aux sens (donc il est, dans l’œuvre, présent en sensibilité, même s’il ne se met pas en scène), se dissoudre dans le paysage, dans la nature, dans l’inconnu (ou dans l’inaperçu). Puisque comme l’affirme Pierre Ouellet « la perte du soi accroît […] le sujet d’une altérité à lui-même qui le libère de ses racines, l’étend dans le temps et dans l’espace »[58], le poète devrait être désormais libre de se disséminer comme les aigrettes du pissenlit, porté par la brise, aux quatre vents. Voguer partout à la fois, se répandre à travers l’immensité, effleurer l’idée d’un cosmos auquel il sait appartenir, modestement. Par son regard poétique, il s’y perd, s’y répand, le parcoure désormais non plus de l’esprit ou des yeux, mais de son être entier, offert à l’expérience incertaine, dangereuse, mais aussi salvatrice du voyage (qu’il soit physique ou mental).
***
Désencombrement
En géopoétique, au « mouvement vers le dehors répond la volonté de désencombrer la pensée »[59]. Désencombrer, faire le ménage. Il faut, pour que l’artiste puisse être disponible à l’expérience du voyage (j’aime bien que ce mot évoque la chimie, puisqu’il implique une réaction, un changement physique de la matière), qu’il se défasse, qu’il se déleste (comme on se débarrasse d’un poids) de ses idées préconçues, de ses systèmes de pensée, de ses préjugés, pour laisser en lui un vide agissant, une ouverture, un lieu d’accueil et de disponibilité, de légèreté, propre à être investi, repeuplé, par ce que le monde a à lui offrir (alors même que l’artiste s’offre à lui en retour) de choses nouvelles, qui surgissent le long du chemin parcouru. Pour créer, il faut au géopoéticien, bien qu’il soit cultivé, nourri par des savoirs variés et complémentaires, atteindre un état de disponibilité qui demande la fin de l’inhumaine certitude. Son esprit ouvert, curieux et avide, le poète pourra enfin être pénétré/ traversé/comblé par ce que le monde a toujours voulu lui offrir, mais qu’il était trop plein pour accueillir.
***
Plasticité et fertilité
Je repense au texte « Knowing your Mind » de Ken Robinson, et en particulier à la notion de plasticité, soit la propriété du cerveau, plus particulièrement active durant l'enfance, de modifier, d’adapter la configuration des synapses selon l'usage qu’en fait l’individu[60] (ce qui explique, par exemple, qu’un enfant aveugle développera des capacités au-dessus de la moyenne au point de vue de l’audition ou encore du toucher), altérant à long terme le développement des capacités cognitives et perceptives de l'individu.[61] Quel est le lien entre cette notion anatomique, celle du voyage et l’approche géopoétique ? Le potentiel de développement humain.
Mais que signifie vraiment le mot « potentiel » ?
1. Ensemble des ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer.
2. En neurologie : Différence de potentiel électrique de part et d'autre d'une membrane cellulaire nerveuse ou musculaire ou entre deux points de la surface du corps et générée par le tissu nerveux ou musculaire.[62]
Réaction à 1 : Le voyage n'est-il pas un fournisseur absolument fantastique de nouvelles ressources/idées/pensées/conceptions pour le voyageur qui se prête à l’exercice géopoétique ? Les humains n’ont-ils pas accès en eux-mêmes à des ressources insoupçonnées, comme le démontre l’expérience de la marcheuse Sarah Marquis[63] ? Réaction à 2 : Le voyage ne donne-t-il pas lieu à une nouvelle décharge électrique dans nos cellules nerveuses et musculaires ? Ne ressent-on pas un déséquilibre, une différence de potentiel électrique, entre deux points du corps, celui de l'habitude et celui du voyage ? N'est-on pas porteur, en tant que membrane cellulaire sur deux pattes, de cette décharge, que le voyage peut enfin induire ? Ne dit-on pas que le voyage recharge les batteries ?
Où veux-je en venir par ce détour étrange ? À l’idée que le voyage, comme la géopoétique, repositionne la perception, les capacités cognitives de l’individu, comme si elles étaient plastiques, malléables, jamais figées (même si la plasticité du cerveau diminue à l’âge adulte[64], les capacités humaines demeurent dynamiques). En se considérant soi-même comme une terre inexploitée recelant un potentiel de fertilité, auquel on peut accéder à force de dur labeur, en arrachant les mauvaises herbes et les souches pourries issues des conceptions mortifères du monde véhiculées par la société occidentale contemporaine, capitaliste et technocrate, on aperçoit en soi (une étude de soi comme une étude de sols) un potentiel immense, des capacités oubliées, desséchées comme des ruisseaux déserts après qu’on ait fait dévier le cours d’une rivière dans un certain sens (toujours le même, dans notre société de droite, qui étrangement, voue un culte au cerveau gauche). Ces aptitudes éteintes, je suis persuadé que l’on peut les raviver par l’électrocution, le choc du corps secoué par la rencontre avec l’altérité, la nouveauté, qui le plongent en crise de sens, le frocent à se réorienter. Cette régénérescence, cette redirection des esprits, ont le potentiel de rallumer nos corps ankylosés par l’habitude, de nous mener à la redécouverte d’une sensibilité humaine ina[perçue], et pourtant en nous. Il faut voir les parts de nos esprits qui sont en jachère non pas comme des déserts, mais comme des territoires fertiles à conquérir/débroussailler/défricher/entrouvrir.
Un monde sacré
« À l'endroit où les lieux et les mots se rejoignent,
on trouve le sacré »
- N. Scott Momaday
En véhiculant énormément de matière,
de matière terrestre, avec un sens élargi des choses et de l’être,
la géopoétique ouvre un espace de culture, de pensée, de vie.
En un mot, un monde. »
-Kenneth White[65]
Un « espace de culture, de pensée, de vie ». Un monde, un espace aimé, chaleureux unissant l’homme à la terre, c’est cela qu’il faut recoudre, rapiécer, retisser, en particulier à l’ère de l’Anthropocène, où l’humain transforme tout en un champ de dévastation, en un vaste immonde. Cela peut sembler utopique, proprement impossible, et pourtant, de Thoreau à Walden jusqu’à Muir dans la Sierra Nevada, en passant par Dillard à Tinker Creek, de nombreux écrivains (bien qu’ils ne se soient jamais réclamés de la géopoétique), à partir de leur sensibilité, de leur pratique du territoire et d’une poésie en mouvement, en relation, tendue vers l’immensité des espaces parcourus, sont parvenus à témoigner dans l’écriture d’une relation si profonde, si riche, si intense avec la, que ces coins de pays sont devenus non seulement des espaces mythiques, mais sacrés, désormais protégés par des lois fédérales. C’est la preuve que malgré la difficulté incommensurable de la tâche, on peut faire de ce monde, parcelle par parcelle, un poème à la fois, un sanctuaire protégé par l’aura protecteur, amoureux, du regard poétique.
[1] White, Kenneth, Le Plateau de l’Albatros, Paris, Gallimard, 1994, p. 25.
[2] White, Kenneth, Ibid.
[3] Bouvet, Rachel, Vers une approche géopoétique, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2015, p.3.
[4] Bouvet, Rachel, Ibid., p.9.
[5] Bouvet, Rachel, Ibid, p.XIX (Avant-propos).
[6] Ouellet, Pierre, L’esprit migrateur : essai sur le non-sens commun, Montréal, VLB, 2005, p.19.
[7] Bouvet, Rachel, Ibid., p.20.
[8] Bouvet, R. et Marcil-Bergeron, M., Pour une approche géopoétique du récit de voyage, Arborescences, numéro 3, 2013, p.5.
[9] « Jean-Paul Riopelle : Hommage à Rosa Luxembourg », Musée national des Beaux-Arts de Québec, consulté le 29 novembre 2016 au https://www.mnbaq.org/exposition/jean-paul-riopelle-1213
[10] « Battures », Isle-aux-Grues, Repéré au http://isle-aux-grues.com/?s=ile-aux-oies&m=permalink&x=battures.
[11] « Histoire des canots à glace », Isle-aux-Grues, Repéré au http://isle-aux-grues.com/?s=canot-a-glace .
[12] « Canot à glace », Musée des Beaux-Arts de Montréal, Repéré au https://expositionvirtuelle.ca/oeuvre-artwork/2001_166-fra.
[13] White, Kenneth, Ibid., p.24.
[14] « Culture », Dictionnaire Larousse, repéré le 2 décembre 2016 au http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072.
[15] White, Kenneth, Ibid., p.24-25.
[16] Ibid., p.39.
[17] White, Kenneth, « Sur l’autoroute de l’histoire », Institut international de Géopoétique, repéré au http://www.institut-geopoetique.org/fr/textes-fondateurs/19-sur-l-autoroute-de-l-histoire.
[18] Turner, Victor W., Le phénomène rituel, Paris, P.U.F., 1990, p.98.
[19] Abram, David, Comment la terre s’est tue : pour une écologie des sens, Paris, La Découverte, 2013.
[20] Glissant, Édouard, Philosophie de la relation : poésie en étendue, Paris, Gallimard, 2009, p.20.
[21] Turner, Victor W., Op. cit., p.96.
[22] « Instructions », Dictionnaire Larousse Français-Anglais [en ligne], consulté le 3 décembre 2016 au http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/instruction/589209.
[23] Avec Pas d’Casque, « La pire journée au monde », Stéphane Lafleur, Montréal, Dare to Care, 2006.
[24] Bouvier, Nicolas, cité par Bouvet, Rachel, Vers une approche géopoétique, Op.cit., p.7.
[25] Turner, Victor W., Op. cit., p.96.
[26] White, Kenneth, « Géopoétique », Consulté en ligne le 25 novembre 2016 au http://www.kennethwhite.org/geopoetique/.
[27] Velay, Serge, « Défaire l’hexagone », dans Cahiers de géopoétique : Géographie de la culture – espace, existence, expression, Nîmes, Éditions Zoé, 1991, p.17.
[28] White, Kenneth, cité par Bouvet, Rachel, Vers une approche géopoétique, Op.cit., p.24.
[29] « Pangée », Encyclopédie Larousse, repéré au : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Pang%C3%A9e/136942.
[30] Ouellet, Pierre, L’esprit migrateur : essai sur le non-sens commun, Montréal, VLB, 2005, p.19.
[31] Ouellet, Pierre., Op.cit, p.11.
[32] Ibid, p.19.
[33] Zourabichvili, François, Qu’est-ce qu’un devenir pour Gilles Deleuze ?, Lyon, Éditions Horlieu, 1997, p.2.
[34] Shiva, Vandana, Pour une désobéissance créatrice : entretiens, Arles, Acte Sud, 2014, p.141.
[35] Ibid.
[36] Ibid.
[37] Bouvet et Marcil-Bergeron, Op.cit., p.9.
[38] Dansereau, Pierre, « Les forces de la nature, les réponses de la culture », dans Vie des Arts, vol.35, no.141, 1990, p.21.
[39] Bouvet, Rachel, Vers une approche géopoétique, Op.cit., p.26.
[40] Ibid.
[41] Lévy, Bertrand, «L’empreinte et le déchiffrement : Géopoétique et géographie humaniste », dans Cahiers de géopoétique : Géographie de la culture – espace, existence, expression, Op.cit., p.30.
[42] Abram, David, Op.cit. , p.56.
[43] Lévy, Bertrand, Op.cit., p.30.
[44] Dansereau, Pierre, Op.cit., p.19.
[45] Lévy, Bertrand, Op.cit., p.34.
[46] Dardel, Éric, cite par Bertrand Lévy, Op.cit., p.29.
[47] Desbiens, Patrice, Désâmé, Ottawa, Prise de parole, 2005, p.41.
[48] White, Kenneth, « Géopoétique », repéré au http://www.kennethwhite.org/geopoetique/.
[49] Lévy, Bertrand, Op.cit., p.27.
[50] Bouvet, R., Marcil, Myriam, Op.cit., p.5.
[51] Ibid, p.4.
[52] Le Breton, David, Marcher : éloge des chemins et de la lenteur, Paris, Métailié, 2012, p.16.
[53] Ouellet, Pierre, L’esprit migrateur, Op.cit., p.45.
[54] Ouellet, Pierre, Ibid.
[55] Velay, Serge, Op. cit., p.13
[56] Lévy, Bertrand, Op.cit., p.27.
[57] Bouvier, Nicolas, paraphrasé par Bouvet, Rachel et Marcil-Bergeron, M., Op.cit., p.11.
[58] Ouellet, Pierre, Op.cit., p.26.
[59] Bouvet, Vers une approche géopoétique, Op.cit., p.30.
[60] Robinson, Ken, « Knowing Your Mind », dans Out of our minds : Learning to be creative, New Jersey, Wiley, p.129.
[61] Robinson, Ken, Ibid., p.129-132.
[62] "Potentiel, Dictionnaire Larousse, consulté le 11 novembre 2016 au : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/potentiel/62998
[63] « Sarah Marquis – TF1/ 7 à 8 par Thierry Demézière », Sarah Marquis, repéré au https://www.youtube.com/watch?v=janYlnNbiy4.
[64] Robinson, Ken, Ibid, p.129-132.
[65] White, Kenneth, Onglet « Géopoétique », Site officiel de Kenneth White, repéré au http://www.kennethwhite.org/geopoetique/.
Bibliographie
Ouvrages théoriques
- Abram, David, Comment la terre s’est tue : pour une écologie des sens, Paris, La Découverte, 2013, 347p.
- Bouvet, Rachel, Vers une approche géopoétique : lectures de Kenneth White, Victor Segalen, J-M. G. Le Clézio, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2015, 261p.
- Bouvet, R. et Marcil-Bergeron, M., « Pour une approche géopoétique du récit de voyage », Arborescences : revue d’études françaises, numéro 3, 2013, p.4-23.
- Dansereau, Pierre, « Les forces de la nature, les réponses de la culture », dans Vie des Arts, vol.35, no.141, 1990, p.14-21.
- Glissant, Édouard, Philosophie de la relation : poésie en étendue, Paris, Gallimard, 2009, p.20.
- Le Breton, David, Marcher : Éloge des chemins et de la lenteur, Paris, Métailié, 2012, p.15-67.
- Lévy, Bertrand, «L’empreinte et le déchiffrement : Géopoétique et géographie humaniste », dans Cahiers de géopoétique : Géographie de la culture – espace, existence, expression, Nîmes, Éditions Zoé, 1991, p.27-35.
- Ouellet, Pierre, L’esprit migrateur : essai sur le non-sens commun, Montréal, VLB, 2005, 205p.
- Robinson, Ken, « Knowing Your Mind », dans Out of our minds : Learning to be creative, New Jersey, Wiley, p.109-138.
- Shiva, Vandana, Pour une désobéissance créatrice : entretiens, Arles, Acte Sud, 2014, p. 140-141.
- Turner, Victor W., Le phénomène rituel, Paris, P.U.F., 1990, p.95-107.
- Velay, Serge, « Défaire l’hexagone », dans Cahiers de géopoétique : Géographie de la culture – espace, existence, expression, Nîmes, Éditions Zoé, 1991, p.9-18.
- White, Kenneth, Le Plateau de l’Albatros, Paris, Gallimard, 1994, 362p.
- White, Kenneth, « Géopoétique », Site officiel de Kenneth White, repéré au http://www.kennethwhite.org/geopoetique/.
- White, Kenneth, « Sur l’autoroute de l’histoire », Textes fondateurs , Institut international de Géopoétique, repéré au http://www.institut-geopoetique.org/fr/textes-fondateurs/19-sur-l-autoroute-de-l-histoire.
- Zourabichvili, François, Qu’est-ce qu’un devenir pour Gilles Deleuze ?, Lyon, Horlieu, 1997, repéré au http://horlieu-editions.com/brochures/zourabichvili-qu-est-ce-qu-un-devenir-pour-gilles-deleuze.pdf.
Œuvres poétiques, musicales, picturales et vidéos
- Avec Pas d’Casque, « La pire journée au monde », Trois chaudières de sang, Stéphane Lafleur, Montréal, Dare to Care, 2006.
- « Canot à glace », Musée des Beaux-Arts de Montréal, Repéré au https://expositionvirtuelle.ca/oeuvre-artwork/2001_166-fra.
- Desbiens, Patrice, Désâmé, Ottawa, Prise de parole, 2005, p.41.
- « Jean-Paul Riopelle : Hommage à Rosa Luxembourg », Musée national des Beaux-Arts de Québec, repéré le 29 novembre 2016 au https://www.mnbaq.org/exposition/jean-paul-riopelle-1213.
- « Sarah Marquis – TF1/ 7 à 8 par Thierry Demézière », Sarah Marquis, Youtube, repéré au https://www.youtube.com/watch?v=janYlnNbiy4.
Informations relatives à l’histoire et à la géographie de l’Isle-aux-Grues
- « Battures », Isle-aux-Grues, Repéré au http://isle-aux-grues.com/?s=ile-aux-oies&m=permalink&x=battures.
- « Histoire des canots à glace », Isle-aux-Grues, Repéré au http://isle-aux-grues.com/?s=canot-a-glace.