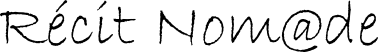Publié le 12/09/2016 - 15:51

carnets: souvenirs et technologie, incompatibilité
ou l’art et la vie
En septembre de l’année passé, j’ai perdu (presque) toutes mes photos de iPhoto. 25 000 photos. J’avais beau les avoir conservées sur un disque dur, les fichiers sauvegardés étaient déjà endommagés. J’ai par contre pu récupéré la majorité des vidéos (incluant une multitude insoupçonnée de petits clips de 0:03 dans le noir, où on entend deux demis mots compris) , les photos et clips de Photobooth, et environ 125 photos de ma caméra qui ont été miraculeusement épargnées.
Dans ma famille, surtout du côté de ma mère, on prend beaucoup de photos. Une sortie à la plage garantit un minimum de 200 photos par personne, et au retour, comparaisons et commentaires sont de rigueur (l’avènement du numérique a sauvé de justesse la fortune familiale). J’ai hérité de cette tare, et donc mes 25 000 photos perdues (je dis ce chiffre-là comme ça, je ne sais pas, mais au moins, sinon plus), ça a fait mal. Je m’en suis voulue, j’en ai pleuré, et j’en suis revenue (dixit Julius) — pas avant que ma mère m’annonce par une malheureuse concordance des astres elle avait perdu trois jours plus tard toutes les photos de mon mariage (dont elle était la seule détentrice), sauf une.
Bon. Donc il me reste des petits vidéos bizarres, qui mis bout à bout, seraient assez éclectiques et n’offriraient un panorama de rien du tout. Le seul que j’aurais voulu garder, qui était vraiment important pour moi, du premier jour à l’hôpital avec Bosko, quand il dormait swaddlé, qu’Alex dormait à côté, et qu’il neigeait dehors, eh bien, scrappé avec les autres (au moins, le commis chez Apple que j’ai supplié en pleurant de récupérer juste celui-là au moins s’il-vous-plait avait l’air compatissant, c’est toujours ça de pris). Donc, j’ai aussi appris une nouvelle attitude; un détachement, sans doute, des photos précieuses et du déclic compulsif.
Maintenant, je me souviens des choses qu’on fait. Je fais parfois des photos avec mon téléphone, mais ce n’est plus la même chose. Mes souvenirs passent par ailleurs; mais des photos perdues, certaines étaient tellement belles qu’elles hantent mon souvenir et me laissent une amertume dans la bouche. Lors d’un journée passée à Bath (Somerset), par exemple, je m’étais proposé comme concept de ne prendre en photo que le sol; j’avais donc une centaine de photos, toutes en noir et blanc, avec parfois mes chaussures préférées (mes Oxford noires en cuir brillant), parfois avec les roues de la poussette, parfois avec les pieds de mon beau-père et un morceau de parapluie — des pavés centenaires, millénaires, des espaces verts et des rues en brique, où s’était certainement écrite une page d’histoire et que tant de pieds avaient fait briller. Dans l’évolution des photos, on pouvait se rendre compte qu’à un moment il avait plu; qu’à un autre, on s’était assis pour manger un morceau; qu’on avait visité les bains romains, et qu’il y faisait particulièrement sombre. J’étais vraiment fière de ce petit « projet », je m’étais promis d’en faire quelque-chose. Les imprimer? Les publier?
Maintenant, la seule image que j’ai de Bath est une photo de nous trois (maman-papa-bébé) faite par ma belle-mère, sur une grande pelouse, au milieu d’un circus dont il fallait se rappeler pour une raison que j’oublie, dans une pose qui semble naturelle et qui l’est. C’est une belle photo, et qui plus est, ma belle-mère a eu la présence d’esprit de l’imprimer. Elle est chez eux, encadrée, sur une étagère dans le bureau, derrière le piano. On la voit pas souvent, mais on la voit parfois. Sur le trottoir devant ces maisons impressionnantes, le trottoir était plein de craques, que je prenais en photo en les imaginant, les unes à côté des autres sur mon écran, tracer une longue ligne.
Je faisais ce projet (et ce n’était pas mon premier) en pensant m’éloigner du déclic compulsif, presque maniaque, propre aux Michel et aux Caillard de ce monde; j’aurais des photos, en lien avec des souvenirs, lesquels resteraient hors-cadre. Je trouvais ça dont beau, de plein de façons. Mais sur mon écran, pas de ligne tracée par le trottoir de Bath; il y a des photos dans le désordre, souvent une seule photo par date, des vidéos étranges, non identifiés. Il va sans dire que le facteur émotionnel en est réduit presqu’à zéro. Beaucoup de ces photos, je les avais téléchargées d’Internet pour une raison x, et elle ne signifient pas grand chose. Beaucoup d’autres encore et un certain nombre de photos qui ne sont pas les miennes.
J’ai, entre autres, une série de photos de ma mère accompagnée de gens que je ne connais pas, qui visitent mon grand-père au Nioubi. Je ne les connais pas mais je connais les photos, je connais les lieux, les paysages; ces quantités de homard, on ne les mange que là-bas. Je vois ces photos et je reconnais l’odeur de la cuisine, qui sentait toujours un peu le pain et les agrumes (jamais d’homme n’a mangé autant de pamplemousses que mon grand-père), avec en sous-jacence une odeur de garage (parce que le garage était juste à côté, à gauche, un garage double immense où on n’a jamais garé aucune voiture, juste des seadoos et des motoneiges quand il y en a eu), je sens sous mes pieds la texture étrange du plancher en petites pierres collés (très eighties), je me souviens de la table en bois trop épaisse, du poids des chaises qui allaient avec, de la table en bois trop épaisse, je me souviens regarder par dessus l’épaule de ma mère qui parle la neige qui tombe dans la nuit, les arbres et la serre à peine distinguables dans l’obscurité, ou, l’été, les herbes folles dans le sentier, les dalles de la montée jamais tout à fait chaudes sous le pied, les mouches noires, les moustiques et les taons, en quantité folle, la rue des Trembles, longue, les voisins que je n’ai jamais vu mais je sais qu’au bout de la rue tous les deux ans un nouveau policier venu d’ailleurs venait s’installer dans la maison grise, les rues de Shippagan, où personne jamais ne marche, les regards quand j’étais entrée à l’épicerie, où j’étais venue à pied en pleine tempête, avec un bouquet de fleurs mortes cueillies le long de l’allée enneigée, ces regards qui disaient « Ah mon doux, les jeunes de la ville », mais cette impunité, d’une façon, puisque j’étais la petite fille du Docteur Michel, et que tout le monde le savait, cette intimité des gens que ce même statut impliquait, les gens qui venaient à la maison, se plaindre de leurs bobos, les détours en chemin vers la plage, pour aller voir Untel ou L’autretel, qui vit dans une maison toute penchée, la même maison où nous raconte-t-il sa mère vivait avec ses onze frères et soeurs, je crois que c’est ce qu’il dit, je ne comprends pas tout, mais je comprends qu’il n’y a qu’une pièce, qu’un seul four à bois, que le plafond penche dangereusement, qu’il doit faire froid en hiver, mais que c’est ici que cet homme mourra parce que c’est ici qu’il est né, qu’il y a la mer à côté et on n’abandonne pas la mer comme ça, et parce que quand on est né ici, il n’y a nulle part à aller, parce que les jeunes de la ville de toute façon ne comprennent pas ce qu’on dit, on n’oublie d’ailleurs jamais cette mer et cette plage pas inhospitalière mais humble, cet horizon qui est en fait la Gaspésie, ce vent qui fouette, un jour, pendant un pique-nique, les petites carottes se sont envolées, un autre jour, avoir marché sur la mer gelée, et un autre jour, préparer un pique-nique composé de sandwichs jambon-sauce donair (mais pas la viande donair quand-même, il y a encore des limites) dans cette cuisine qui sent le pain, les agrumes, le garage, mais un peu sucré aussi, peut-être les Froot Loops (qui étaient toujours passés date), je connais par coeur les odeurs et les sensations de ce petit bout de péninsule dont je ne pensais jamais m’ennuyer autant.
J’ai donc un trou, comme Perec dans W, (un peu moins traumatisant quand-même, je l’admets), et je tricote autour. J’ai fini d’en pleurer, j’en suis revenue. Je me concentre sur la création. Les souvenirs se feront, ils resteront, d’une façon ou d’une autre.