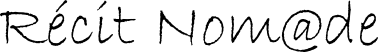Publié le 09/26/2016 - 13:18
En arabe « la petite mort » désigne le sommeil.
Chaque soir, nous mourrons. En petitesse, puisqu’habituellement il y a réveil. C’est donc une mort éphémère.
La petite mort peut aussi être le résultat du temporaire. Je tente de l’entrevoir plutôt comme une beauté fugace permettant d’atteindre de jolies intensités.
Le voyage peut être petite mort. Car son caractère est volatile, ce qui le rend unique. Sa fin est aussi une petite mort. Pourquoi donc terminer l’expérience même en sol routinier ?
Voyageons.
— 25.09.2016
Les nouveaux cours revêtent une haine commune envers l’image.
« Je suis aveugle. Mon acuité se précise par les sons trameurs, les odeurs qui surfent, les nuances gustatives sur ma langue. Je n’arrête pas de regarder ardemment tout ce que les yeux omettent. »
Voilà des propos imaginés, surgissant suite à la rencontre récente avec un individu non-voyant.
Lorsque je marchais en sa compagnie jusqu’aux portes du métro le menant à son antre, désinvolte il constatait tant de faits m’étant encore inconnus.
Nos pas valsaient sur les quais avec un bruit lointain, signe d’un métro qui se peaufine. Il en fit la remarque avant même que mes yeux puissent noter les constructions amorcées, en utilisant fréquemment les verbes « regarder » et « voir ». Ils ne se restreignent pas à la fonction des yeux.
Voir d’oreilles. Voir de nez. Voir de mains. Voir de bouche.
Le surplus d’images endort ma rétine. Petite mort de l’œil, je tente de réveiller l’enfoui.
— 30.09.2016
J’ai toujours ressenti l’angoisse des ascenseurs. Lorsque j’embarque dans l’une d’elles, je regarde avide de son arrivée les numéros grimper, parfois trop tranquillement.
Je me rends compte tout de même que lorsque je suis en compagnie dans cette boîte mobile, mon cœur n’est plus aussi agité. J’ai probablement beaucoup plus peur de l’âme close que des endroits clos.
.
— 05.10.2016
Mon vélo roule, je le transporte d’une main, l’autre se balade le long de mon corps. J’écoute les propos d’une amie qui comme moi, marche d’un pas énergique, éprise par notre conversation. Elle me dit : « Jouons aux couleurs. » Elle m’explique rapidement les règles. Puis, elle dit : « Flaubert. » Je réfléchis. Quelle couleur représente cet écrivain ? J’ai trouvé, elle me semble adéquate, je ne peux plus entrevoir une autre réponse. Elle me dit : « Bleu pâle. » Est-ce si fou que d’avoir eu la même couleur en tête ? Exactement. Avec la précision de sa pâleur. À mon tour, je dis : « Kafka » Rouge. Rouge. Idem.
Les couleurs sont-elles associées à un concept? Des adjectifs, des mots, un langage qui les caractérise. J’arrive dans mon cours d’allemand. Je joue aux couleurs avec ma nouvelle connaissance non-voyante (nommons-là Ophélie), je suis trop curieuse, elle est si réceptive à mes questions probablement lassantes... Je lui dis : « Le professeur, quelle couleur lui donnes-tu ? » Nous réfléchissons. Puis, je dis : « Jaune. » Elle me répond : « C’est presque pareil. J’ai orange foncé. » « Orange foncé. Tu es si précise ! » « Il le faut. Ce n’est pas pour rien que j’apprends l’allemand. Une langue précise. »
La précision du langage. L’importance de transmettre justement, avec un choix de mots précis, pensé, réfléchit.
La précision de mes idées s’« acuite » lorsque j’ai des conversations avec Ophélie. J’utilise des mots qui tendent vers l’exactitude de ma pensée. Il est si ardu, c’est un beau labeur que l’absence des images. Je lui demande, curieusement : « Comment définis-tu les couleurs ? » « Avec les fruits notamment, par exemple le rouge, je l’associe au goût des cerises, des fraises... »
Certes, le goût caractérise aussi... Mes yeux me sont parfois œillères. Je dois ouvrir le champ des sens ! Il étoffe les textes.
— 04.12.2016
« L’homme est un être versatile, et il se peut que, semblable au joueur d’échecs, il n’aime que l’action même et non le but à atteindre. » — Carnets du sous-sol, Dostoïevski
« Évadé ! libre ! libre comme il arrive dans la défaite de l’habitude. » — Mrs Dalloway, Virginia Woolf
Joli sentiment d’abandon que d’être ici. Par mon désir avide de partir, malgré les tâches étudiantes qui m’inondent, je valse entre l’interruption des habitudes et la concentration nécessaire à la création, dans un lieu qui n’est point chez moi. Toronto.
Avec L, on quitte Montréal. Déjà crinqués par le trajet en autobus, qui nous permet de se détacher du quotidien, il est ponctué par nos rires d’abandon, et des folies de l’existence. On débarque dans un microfestival — Videodrunk —, pour alimenter nos cerveaux d’images et d’idées complètement éclatées. L est vêtu d’une longue veste beige avec un collier qui résonne lorsqu’il se déplace, tandis que moi, je m’amuse à la subtilité, mon foulard rouge rompt toutefois l’incognito.
Le lendemain, ma gorge s’enflamme d’avoir peu dormi. Je dois me lever, trouver un café paisible pour pondre des mots. Je sors de notre maison d’accueil — des amis à L — avec une première image qui m’aveugle ; les gratte-ciels de Toronto. Je ne suis pas chez moi, mon cœur sourit, c’est trop l’fun être déconnectée. Un local m’attire, j’y reste la journée entière, à écrire. Étrangement, ma fatigue se tait pour laisser place à une concentration qui m’étonne. J’oublie même de manger, et quelques curieux m’abordent, en voyant mon appareil photo que j’avais sorti plus tôt de mon sac à dos, afin de trouver un crayon bien enfoui dans son fond. Ces échanges me ramènent à la légèreté d’avoir pris la route, ils tranchent avec l’emprise parfois du connu, qui nous fait oublier d’absorber ce qui nous entoure. J’absorbe et j’écris.
Le soir, je rejoins L dans un restaurant, à 18 h 26. Rassasiés, on se fond dans la nuit, prêts à accueillir l’imprévu pour vivre de symbiose notre désinvolture.
Dans un petit Baber shop, l’intensité de nos conversations enlumine le voyage... nous baignons dans le partage, dans nos pensées communes... Encore épris par la musique live du band torontois, on danse dans les rues. Une jeune femme, habillée de noir, avec un petit chapeau qui vient légèrement entraver son visage, reste nonchalante, en nous disant ; « Have a nice night », sans exclamation, simplement. Elle continue son chemin dans le soir de Toronto, tandis que nous, joliment troublés par cette intervention inattendue, décidons de l’imiter. Notre marche vers la station de bus s’alimente de nos paroles lancées à des inconnus « Have a nice night.........Good evening....enjoy your night....!! »
Les réactions surprises, indifférentes, même muettes nous font écho. Douce déambulation, elle nous unit bien à la ville, à ses habitants.
On embarque dans l’autobus, moins emballés qu’à l’allée... Bref voyage à l’état binaire, tu m’as exalté, je suis maintenant prête au sprint des longues heures confinées à l’écrit.
— 05.12.2016
La demi-pause.
Dans une partition, momentanément elle fige le son. Pour créer un global musical, qui s’enchaîne, et trouve la juste balance entre le silence et les notes.
La musique se cadence par divers silences ; elle en possède plusieurs, lui permettant de nuancer le rythme.
Les mots sont aussi sonorités. Le langage possède lui aussi ses outils rythmiques afin de créer la vague musicale recherchée.
Pourtant, la demi-pause, je la transpose difficilement par les moyens proposés. Cette demi-pause, qui ne veut en aucun cas clouer une phrase, mais qui cherche à poursuivre, à préciser.
Le silence binaire souffle la recherche des mots justes, marque une hésitation légère, qui charme le musical par sa recherche du réel. Il permet une réflexion brève.. le dernier souffle de la phrase précédente. Avant la petite mort. D’une idée, d’un contexte...
Les deux points (..) enchaîne par son silence (demi-pause) la suite d’une pensée entamée.
— 10.12.2016
Le surréel, exponentiel au sein du voyage.
Des petits moments qui sortent de l’ordinaire, venant rompre avec l’habituel.
Je raconte à L un évènement que j’ai vécu, qui m’avait drôlement bouleversé. Voici le récit de cet évènement :
Clignotant à gauche. La voiture grise se tient dans la rue, en tête d’une file ; les véhicules attendent le signal vert pour sprinter vers leurs destinations. L’Une — jeune personne quelconque se tenant à proximité — traverse la rue, les chiffres décroissants pressent ses pas. Elle rencontre un regard effrayé qui fixe quelque chose qu’elle ne peut voir. Curieuse, l’Une, dorénavant sur le trottoir, se tourne pour percevoir ce que l’autre a perçu ; elle perçoit. Son regard devient aussi horrifié que celui croisé plus tôt. La voiture en tête empêche le passage des roues qui attendent, derrière ; celles-ci expriment, avec l’aide du klaxon, leurs impatiences. Il n’y a personne qui contrôle cette carcasse grise, créant un chaos général, par les automobiles frustrées d’être ralentis, et par les piétons spectateurs, leurs visages stupéfaits devant l’impossible de la situation. L’Une regarde la voiture grise qui s’entête à rester immobile, à rester indépendante ; son propriétaire s’étant absenté. L’Une quitte le recoin du trottoir, pour continuer sa marche sous les klaxons qui transmettent la rage des empressés.
Louis réagit en me racontant, lui aussi, un évènement qui l’avait, pour un instant, fait chavirer.
Fauteuil roulant qui fugue. L’Un — individu quelconque se baladant sur la même artère — regarde la scène d’horreur devant lui. Le fauteuil roulant accélère, ses compétences électriques maintiennent son poursuivant à une distance rassurante. L’Un, abasourdi, foule les roues de la victime, voulant comprendre la situation improbable qui se manifeste devant lui. Le poursuivant crie des paroles incomprises, le fauteuil roulant tente de piéger son agresseur en bifurquant rapidement vers la gauche, empruntant une petite ruelle. L’Un continue ses entreprises détectives, voyant que ses deux sujets d’enquête ne lui sont plus visibles, il court pour les rejoindre, tourne dans la même direction, pour arriver sur une ruelle déserte. Où sont-ils, il doit absolument savoir, son cœur s’accélère, la curiosité le gruge, la réponse à l’énigmatique évènement l’obsède. L’Un continue sa cavale dans les coulisses des rues. Ses yeux notent au loin la victime en danger, son traqueur ayant réduit à quelques mètres l’écart qui les sépare. Le poursuivant agrippe les épaules de celui assis sur le fauteuil roulant. L’Un court vers eux, il doit empêcher l’agression. Plus il s’approche, plus il devient confus. L’Un entend : « ... c’est moi ! N’est pas peur... c’est juste moi… » L’Un ralentit, jusqu’à s’immobiliser, afin de rester dans l’angle mort des deux autres : « Ah. Mais qu’est-ce que tu fais ici ?! Je voulais te faire une surprise… » L’Un retourne à sa marche, rassasié par la résolution de l’énigme.
L’Un qui, devant le surréel, cherche obstinément la vérité. L’Une qui, devant le surréel, s’enfuit, préférant inventer une vérité... Par la mise en relation de ces deux récits, L et moi cherchons un sens. Pendant un instant, L et moi nous avons, à haute voix, fait un cheminement d’idées qui se fait habituellement seul, avec nous-même. Toujours lors de la marche nocturne, L me raconte que les possibles sont tous déjà existants, et c’est par la découverte que nous perçons leur mystère. Que ce soit vrai ou faux, ce qu’il me dit me semble bien angoissant... que tout soit déjà écrit…
L m’interpelle : « Tu vois le banc de l’autre côté de la rue ? Et bien, toutes les possibilités pour l’atteindre existent déjà. » Il décide de s’y rendre en tournant sur lui-même. Ensuite, en sautant... La création serait donc une découverte pour L, puisque ce qui est créé existe déjà. J’angoisse. Je préfère penser, que les écrivains, écrivaines de ce monde invente la manière de se rendre jusqu’à ce banc.
Je pense avoir compris pourquoi cette manière de penser le créatif me trouble ; le processus créatif est vu comme une fatalité. C’est-à-dire qu’il n’est pas libre ; et si la création n’est pas libre, qu’est-ce qui l’est ?
INVENTION — DÉCOUVERTE
L’Un voit la création comme découverte de la vérité.
L’Une voit la création comme invention d’une vérité.
Le voyage permet de voir encore plus ces moments surréels, de les capter.
Puis. Les écrire.
— 17.12.2016
« Écrire c’est n’être personne. '' Mort '' disait Thomas Mann. Lorsque nous écrivons, lorsque nous appelons, déjà nous sommes pareils. Essayez. Essayez alors que vous êtes seul dans votre chambre, libre, sans aucun contrôle de l’extérieur, d’appeler ou de répondre au-dessus du gouffre. De vous mélanger au vertige, à l’immense marée des appels. » — Le Navire Night, Marguerite Duras
Te sens-tu personne ? Te sens-tu personne ? …
Te sens-tu morte ? Morte ? … morte
Écrire… Me sentir morte, non.. mais
L’écriture comme petite mort.
Petite, pourquoi ?
« La petite mort peut aussi être le résultat du temporaire. Je tente de l’entrevoir plutôt comme une beauté fugace permettant d’atteindre de jolies intensités. » Te souviens-tu de ça ?
Eum… oui, au tout début ?
Oui… petite car écrire c’est une mort, mais brève, fugace...
...
Je retourne à l’écriture maintenant…
Tu vas mourir?
Ce n’est que temporaire.
C’est beau.
C’est fugace.
C’est vrai.
Ich sterbe.
Je meurs.
Je suis morte.
Et tu renais... par quoi ?
Par L’autre...
Le langage… les autres…
LES MOTS.